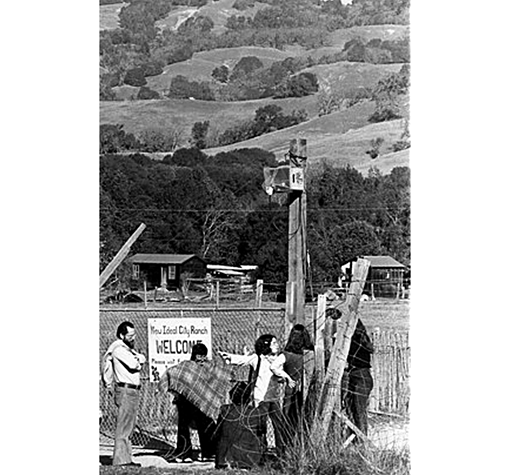Billet pour le ciel par Josh Freed, partie 2
Chapitre IV
Une route de gravier qui semblait ne devoir jamais finir se termina brusquement à une barrière en fil de fer barbelé, flanquée d’une guérite en bois. Il était minuit. Partis trois heures plus tôt de San Francisco, nous arrivions enfin. Les phares de la camionnette éclairaient une affiche où l’on pouvait lire: La ferme modèle de Boonville.
Mon coeur chavira, au bord de la nausée. Ce que je savais de ce camp m’avait rendu craintif. Ne m’avait-on pas certifié à maintes reprises que bien des gens avaient subi ici un changement complet de personnalité? On affirmait même qu’un universitaire venu pour préparer une thèse de doctorat s’était laissé gagner par la propagande de la secte. Par ailleurs, un journaliste dont j’avais lu le reportage racontait qu’en fuyant, après un séjour de 48 heures, il s’était mis à vomir et à être victime d’hallucinations.
Nerveux et inquiet, j’avais remis à Marilyn un document signé de ma main où je l’autorisais à venir me chercher de force si je ne voulais pas sortir du camp de mon propre gré. Mes appréhensions avaient encore augmenté au moment de quitter le quartier général, rue Washington. On avait exigé que je mette mon nom au bas d’une formule dégageant Le Projet de la commune créativité de toute responsabilité en ce qui concernait l’expérience du « séminaire ».
Une vive anxiété me torturait donc quand je sortis de la voiture et commençai à patauger dans le foin mouillé. D’autant qu’une brume épaisse alourdissait les ténèbres, supprimant presque toute visibilité.
On nous dirigea vers un sombre édifice aux parois de métal en nous recommandant de nous coucher tout de suite.
Un type qui avait l’air d’un jeune Jack Nicholson voulut ressortir.
— Je vais seulement fumer une bonne cigarette, dit-il.
Un Moonie le refoula avec fermeté vers le dortoir:
— Il est préférable que vous ne fumiez pas, lui dit-il. Et nous apprécierions que vous vous mettiez au lit sans tarder. Vous aurez demain une journée longue et fatigante.
Directement sur le plancher de la grange, il y avait de minces matelas. La plupart étaient déjà occupés par des dormeurs. Il en restait pour nous, les nouveaux arrivés.
Une pluie légère commençait à faire tinter la toiture de tôle. Au loin, le vent hurlait.
Je me couchai près de « Jack Nicholson » qui me paraissait un brave type. Quand les lumières s’éteignirent, il sifflota un moment, puis murmura:
— Bi-zarre!
La mélodie mélancolique de la pluie se poursuivait quand je fus tiré d’un sommeil agité par un chœur de chanteurs aux voix puissantes qui poussaient allègrement la chanson Raindrops Keep Falling on my Head, popularisée par Frank Sinatra. Dans le temps de le dire, tout le monde fut debout, occupé à s’habiller en vitesse. Puis, en quelques minutes, un cercle se forma pour chanter des refrains entraînants.
« Bonjour, les gars! » s’écria soudain un guitariste rayonnant de propreté et affichant un sourire aussi large que celui des annonceurs de pâte dentifrice. « Comment allez-vous? »
« Merveilleusement BIEN! » répondirent des douzaines de voix à la fois tonitruantes et enjouées. On me saisit les mains et l’on m’entraîna, pour une trentaine de minutes, dans une bruyante et joyeuse farandole.
C’était un mardi. Sept heures du matin. Au dehors, pluie fine et pénétrante. À travers mes yeux à peine ouverts et clignotants, je voyais le rythme de la vie à Boonville démarrer à une allure endiablée.
Dans une jolie clairière située au milieu de la forêt de Mendocino, à environ 120 milles au nord de San Francisco, le vaste camp Boonville — 650 acres — comptait de très simples installations matérielles. Au centre, entouré de champs herbeux, un groupe de maisons-remorques logeaient les dirigeants. Au loin, la forêt se découpait sur un horizon uniformément plat. Une clôture en fil de fer barbelé, haute de huit pieds, encerclait la propriété. Et moi, j’étais là, respirant l’air pur de la campagne, me laissant réchauffer par la bienveillance d’une jeunesse épanouie. Mes craintes paranoïaques de la veille se dissipaient. Quoique un peu austères à mon goût, les Moonies ne m’en apparaissaient pas moins, ce matin-là, comme des gens fort sympathiques. Les racontars à leur sujet n’étaient-ils pas exagérés?
L’édifice où nous avions passé la nuit était un grand poulailler désaffecté à qui on avait donné le surnom bien significatif de Palais des poulets. Les filles et femmes, elles, dormaient dans des roulottes à part. Sur les portes des salles de bains — vastes cabines de bois — , on lisait d’un côté « Frères » et de l’autre « Sœurs ». Dans la salle des hommes, l’on trouvait de tout, depuis la crème à barbe et la soie dentaire jusqu’à des rangées de brosses à dents. Un lot de jeunes se rasaient. « Veux-tu te barbifier, toi aussi? » me demanda l’un d’eux, en pointant du doigt ma barbe frisottée. Je le remerciai de son offre sans l’accepter.
Presque tout de suite après, un autre Moonie me prit par la main et m’entraîna vers le Palais des poulets où venait de commencer une période d’exercices physiques. Pendant 45 minutes, on fit alterner la marche, la course, les sauts, avec « l’assouplissement des orteils » et « le balancement d’éléphants sur les épaules ». Le tout, coupé d’applaudissements et d’acclamations dont la plus populaire était le « chooch ». L’on se tenait alors bras dessus bras dessous et l’on criait de toute la force de ses poumons: « Ch-ch-choo, ch-ch-choo, ch-ch-choo, Yea! Yea! POW!! »
La plupart des recrues trouvaient le « chooch » plutôt insignifiant, mais y participaient quand même, par politesse. « Autrement, comment ne pas offenser nos hôtes? » semblaient-ils se dire. Presque tous étaient des garçons. En apparence normaux, ils se distinguaient des Moonies par leur tenue négligée et leurs cheveux en broussaille. L’un d’eux, Keith, « l’homme des montagnes », était mon favori avec son air hippie à la Paul Bunyan. Je ressentais à son égard une sorte de sympathie instinctive. Il prétendait venir d’un village de la Caroline du Sud au nom farfelu: La Gloire des Fainéants. Sur sa tête aux longues tignasses, un vieux chapeau tout cabossé. Au verbiage des meneurs, mon homme réagissait par des discrets « oui » ou « non ».
Chacun de nous était pris en charge par un Moonie de sexe opposé. C’était Bethie qui s’occupait de moi. Elle avait promis à Benji de m’« adopter », m’expliquait-elle. Prenant son rôle au sérieux, elle me stimulait sans arrêt vers une participation toujours plus active.
Jusque-là, la vie chez les Moonies se caractérisait par une sorte de mouvement perpétuel, un bavardage incessant et de constantes pressions de mains. On me posa des douzaines de questions sur ma vie personnelle et sur mon amitié avec Benji. Sans me laisser le temps de souffler, on m’incitait à parler, à chanter, à crier des acclamations.
Quand arriva le moment du petit déjeuner, quelque 90 minutes après le réveil, j’étais aussi désireux de retraite et d’intimité que de café et de compote aux pommes. Hélas! je le découvris bientôt, même les repas à Boonville forment un maillon essentiel de la chaîne ininterrompue des activités de la journée.
L’exubérante Bethie nous dit, de façon très engageante:
— Durant les repas, nous avons l’habitude de partager quelque chose avec les autres… D’ordinaire, on se fait mutuellement de petites confidences, rien d’important, de tous petits détails personnels, pour mieux se connaître.
En fait, « partager » exigeait de se livrer à des révélations sur ses réactions émotives à l’occasion de tel ou tel incident survenu dans le passé. Au déjeuner, les échanges portèrent sur des événements insignifiants. Toutefois, à mesure que la journée avançait, on passa à des confessions allant du simple geste égoïste aux expériences sexuelles les plus sophistiquées. Même les recrues se livrèrent à des aveux intimes et graves. Devant la franchise et l’ouverture des anciens, il leur paraissait sans doute impoli et grossier de s’abstenir.
Heureusement, j’avais déjà appris d’ex-Moonies que les animateurs des « séminaires » discutent entre eux de ces confessions, cherchant à trouver les points les plus faibles des candidats éventuels et leurs principaux sentiments de culpabilité.
J’avais préparé mon récit, me tenant assez près de la vérité pour ne pas trop contredire Benji qui avait dû parler de moi. Toutefois, pour brouiller les pistes, j’ajoutai quelques détails plus ou moins exacts. Je prétendis, par exemple, être en année sabbatique pour m’évaluer moi-même et décider si j’allais rester journaliste. Comme les autres, à la fin de mon « partage », je fus applaudi.
Durant le repas, on assaisonna ma soupe et ma viande, on mit du lait et du sucre dans mon café, on fit tout pour moi sauf de porter les aliments à ma bouche. À mesure que je répétais les mercis avec une monotone régularité, je sentais croître en moi un fort déplaisir de me voir obligé à de la gratitude à cause de toutes ces attentions.
De plus, on tenait et on caressait mes mains comme si elles eussent été une propriété commune.
À sa première allocution, Bethie nous affirma qu’il était difficile d’être généreux et désintéressé, de chercher le bien des autres avant le sien propre. « Il est difficile, disait-elle, de ne pas se laisser dominer par l’égoïsme. »
Notre conférencière se tint debout au tableau noir au moins une heure durant. J’ai calculé qu’elle a employé le mot égoïsme plus de trente fois.
À un moment donné, elle dit, avec un petit air entendu, comme si elle devinait nos pensées:
— Il est difficile de chanter ou de tenir une main froide et moite quand ça ne nous plaît pas, simplement pour faire plaisir aux autres. De nos jours, les gens ne se soucient que d’eux-mêmes.
Comme celle de Kristina, rue Washington, la conférence de Bethie se présentait comme une improvisation. En réalité, elle était préparée jusque dans les moindres détails, avec un judicieux dosage d’histoire, de science, de philosophie et de psychologie. L’ensemble constituait une impressionnante invitation à construire un monde merveilleux.
Je notai que les idées défilaient à grande vitesse comme les wagons d’un train express. Il était impossible d’en faire un examen critique.
Si mes yeux vagabondaient, n’était-ce qu’un instant, un membre de la famille me poussait du coude:
— Josh, essaie d’écouter. Cette partie-là est particulièrement importante.
Le second jour seulement, je m’aperçus que même la disposition des auditeurs dans la salle n’était pas laissée au hasard. Comme recrues, nous étions chacun entouré d’anciens, chargés de nous rappeler à l’attention au besoin.
Lors de la deuxième conférence, on nous enseigna que tout sentiment est faible tandis que la discipline de l’esprit est forte. On nous invita à accepter de bon cœur ce qui, à première vue, pouvait nous sembler curieux et peu raisonnable. Enfin, on nous conseilla de ne pas parler seul à seul avec les autres recrues. Nous éviterions ainsi un renforcement mutuel de notre négativisme.
En conclusion, Bethie nous dit:
— Ici, à Boonville, nous essayons de créer une communauté modèle où les gens agissent, non selon leurs sentiments, mais selon un idéal. Regardez. Observez. Profitez de ces deux jours pour expérimenter une nouvelle façon de vivre. Ne vous laissez pas déconcerter par ce qui peut vous paraître un peu bizarre ou inquiétant. Résistez à la tentation de retourner chez vous avant demain soir. Tenez bon!
Retourner chez nous? Était-ce possible? Nous étions à 120 milles de San Francisco. Où exactement? Nous l’ignorions. Et il n’y avait sur place que des voitures appartenant au mouvement et dont nous ne pouvions pas nous servir.
Après chaque conférence, nous nous réunissions en petits groupes pour échanger nos réactions. Quand nous posions des questions embarrassantes, les animateurs, ou bien les esquivaient avec habileté, ou bien en remettaient la réponse à plus tard. « Ne nous attardons pas, disaient-ils. Ce problème sera bientôt étudié au long et au large. Vous verrez, tout sera très clair. » (Ces promesses ne furent jamais tenues.)
Puis nous étions repris dans la tornade étourdissante des chants et des caresses de mains, avec l’inévitable et superbruyant: « Ch-ch-choo, ch-ch-choo, ch-ch-choo. Yea! Yea! POW!! »
C’était épuisant. La tête me tournait. Trop de bruit! Trop d’activités! Pas une minute pour réfléchir, pour rêver! La moindre tentative d’évasion vers le calme et la paix avortait. Sans cesse, il fallait parler, écouter, chanter, crier. J’en étais tout étourdi. Le temps lui-même devenait une chose floue, insaisissable. J’aurais payé cher pour voir une montre ou une horloge et savoir s’il était midi ou quatorze heures.
Soudain, Bethie annonça: Pause-café! Je bondis sur mes pieds et me précipitai vers la sortie pour aller respirer un peu et me détendre. Je n’avais pas fait trois pas qu’une main se posa sur mon épaule. J’entendis une voix doucereuse me dire:
— Comment aimes-tu cela, Josh?
Je m’arrêtai. À quelques pouces de la mienne, il y avait une figure boulotte et flasque. C’était Jim, un gros bonhomme, porteur de lunettes qui semblaient taillées dans un fond de bouteille de Coke. Son sourire habituel, un sourire vide, me rappelait celui du robot à figure humaine qui apporte son café à Boris Karloff dans certains films d’horreur. Je balbutiai:
— Bien… En fait… Franchement, je n’ai pas eu le temps d’y penser… Laisse-moi y songer… Je te donnerai mes impressions plus tard…
Le type ne me lâcha pas pour si peu.
— À quelle partie de la conférence, dit-il, vas-tu surtout penser pour te faire une opinion?
— Écoute, répondis-je. J’ai besoin de me retrouver seul quelques minutes. Je vais prendre l’air.
— Merveilleuse idée! dit-il en m’enlaçant d’un bras. Je t’accompagne.
J’allais le repousser de nouveau. Je m’en sentais coupable. Mais c’était plus fort que moi. J’éprouvais un besoin viscéral de solitude. Fixant l’importun dans les yeux, je lui dis un seul mot, mais catégorique:
— NON!
Et je partis à la course. Extraverti comme je le suis de nature, je n’ai pas souvent le désir de me retrouver seul. Mais je puis dire qu’à ce moment-là je goûtai intensément mes quelques minutes de solitude. Quelques minutes seulement, car je fus vite rejoint par deux jeunes filles qui m’interpellèrent joyeusement « Josh! Josh! Josh! », comme si elles rencontraient un ami très cher après de longues années d’absence.
— Ah! Josh! tu es un fichu d’original, gazouilla l’une d’elles.
Sans plus, elles se mirent à me sortir les mains des poches pour les caresser amoureusement. Quelques minutes plus tard, après un rapide café, je me retrouvais dans la salle de conférences.
— On traita Christophe Colomb de fou, dit Bethie, mais 50 ans plus tard une colonie se fondait en Amérique du Nord.
À peine cette assertion énoncée, plusieurs membres de la famille se levèrent comme mus par un enthousiasme spontané et crièrent à la façon d’acteurs d’un théâtre amateur:
— Tu es un imbécile, Christophe Colomb! Tu es une tête brûlée!
Bethie continua:
— On traita Orville Wright de fou. Même sa propre mère le croyait anormal. Mais, de nos jours, des hommes ont marché sur la Lune… A la lumière de ces événements, on peut se demander aujourd’hui s’il est tellement fou de rêver à un monde meilleur.
Des idées de ce genre, la conférencière en répétait sous les formes les plus diverses au point de les rendre hypnotisantes.
— Le scepticisme, reprit-elle, se classe parmi les manifestations du négativisme. Or le négativisme nous empêche d’avancer sur la route du bonheur… Penchez-vous sur votre passé. Vous avez sans doute connu des moments de joie parfaite. Eh bien! quand vous aurez atteint la complète maturité, vous vivrez en permanence dans ce genre d’extase que vous avez expérimentée seulement de temps à autre. Finies les insécurités! Finies les inquiétudes!
Suivirent des statistiques, sombres comme la fumée qui sort de la cheminée d’une locomotive. Chaque année, paraît-il, 1,6 million d’adolescents fuient le foyer paternel. Un adolescent sur 100 est tué. Un sur 80 est battu. La télé, l’immoralité, les drogues menacent le monde. Malgré la bonté de son principe initial, le communisme est devenu un fléau… Si vous donnez 1000$ à quelqu’un, il vous dira volontiers que vous êtes un type parfait. Ici, pour 18$, on vous dit que vous êtes égoïste et cupide.
De temps à autre, Bethie citait des autorités prestigieuses comme Toynbee, Spengler, Einstein, Maslow, Mao, Bouddha et Confucius. Ses exposés devaient être structurés selon une rigoureuse logique. Mais, moi, je ne suivais plus. Je me sentais perdu sur cet océan de noms, de dates, de principes, d’énoncés, de preuves, d’axiomes, d’inductions et de déductions. J’en avais le mal de mer. Mais si je laissais paraître mon désarroi mental en me montrant le moindrement distrait, un coup de coude fraternel me rappelait à l’ordre.
Au milieu de cette confusion, mon esprit n’était pas cependant anesthésié au point de m’empêcher de noter un fait des plus importants: à aucun moment, ni de façon directe ni de façon indirecte, quelqu’un fit allusion au créateur de la philosophie qu’on nous exposait. Personne, absolument personne ne mentionna le Révérend Sun Myung Moon.
Je commençais à en avoir par-dessus la tête. Les chants et les acclamations me bourdonnaient sans cesse dans les oreilles. Le « chooch » écorchait ma sensibilité comme la craie lorsqu’elle grince sur un tableau noir. Les sessions de partage devenaient si intimes que j’en étais mal à l’aise. Que dire des constantes caresses de mains? Je les trouvais proprement insupportables. D’autant que certaines de ces mains qui emprisonnaient les miennes étaient ou collantes, ou flasques, ou râpeuses comme du papier sablé, ou visqueuses comme des serpents.
Curieux mélange d’école maternelle, de camp scout et d’hôpital psychothérapique, le séjour à Boonville me tombait sur les nerfs. Sans doute, d’autres recrues devaient connaître des réactions analogues aux miennes, mais elles en attribuaient probablement la cause à leur égoïsme. Elles faisaient alors appel à leur générosité foncière pour tenir bon et continuer leur participation active. Le silence qu’on nous avait imposé entre nous nous empêchait de comparer nos impressions et de renforcir nos doutes. Chacun, enfermé dans son petit monde, se pensait le seul contestataire et se demandait de plus en plus s’il avait raison dans sa contestation.
De toute évidence, quelques recrues étaient déjà conquises sans réserve à la cause, gagnées par cette expérience, étrange il est vrai, mais combien sincère et séduisante à leurs yeux. Quant à moi, seul le cynisme inné qui m’a toujours caractérisé m’a permis de résister consciemment, bien qu’avec discrétion, à l’endoctrinement.
Cet après-midi-là, on nous amena en camionnette jusqu’à un vaste terrain d’athlétisme pour y jouer une partie de baseball. En chemin, grâce au bruit de ferraille de la voiture, je pus converser avec Keith, « l’homme des montagnes ». Ou plutôt, j’écoutai. Le drôle me parla de l’organisation des loisirs à son village « La Gloire des Fainéants ». Là, disait-il, on s’amuse de façon originale, qu’il s’agisse du concours annuel du meilleur Ragoût de punaises, de la toujours chaudement contestée Course de grenouilles, ou des joyeuses compétitions entre les Gros mangeurs de patates… Keith me conta aussi qu’il avait vécu cinq ans dans des camps de bûcherons… et six mois en prison pour fabrication d’alcool frelaté. Il pouvait garantir l’exacte dimension de la cellule qu’il avait occupée: 144 briques sur la longueur, 42 briques sur la largeur, avec 114 rivets pour tenir le tout.
Dès l’instant où nous sommes arrivés au terrain pour ce qu’on nous avait annoncé comme la pause de l’après-midi, on nous divisa en deux camps. Puis, sans tarder, on nous demanda de chanter et de crier aussi fort que possible. Le tapage de mon équipe s’interrompit seulement pour permettre à notre capitaine de nous donner des instructions et de fouetter notre enthousiasme.
— Nous allons les battre! dit-il. Nous allons les battre à plate couture si bien qu’ils ne sauront même pas ce qui leur arrive… Et pourquoi les vaincre ainsi?
Les anciens donnèrent à cette question une réponse inattendue:
— Parce que nous les aimons, crièrent-ils d’une seule voix.
« Ya — aa — aa — yyy! »
Alors nous commençâmes à hurler un curieux refrain de ralliement:
VAINCRE PAR AMOUR!
VAINCRE PAR AMOUR!
VAINCRE PAR AMOUR!
Et l’on cria cette ritournelle sans interruption jusqu’à la fin de la partie. Au besoin, les anciens encourageaient les recrues à maintenir le bruit à son maximum: VAINCRE PAR AMOUR! VAINCRE PAR AMOUR! VAINCRE PAR AMOUR!
L’équipe adverse répondait, à tue-tête, elle aussi, par une acclamation du même genre: ABATTRE PAR AMOUR!
ABATTRE PAR AMOUR!
ABATTRE PAR AMOUR!
Le tintamarre se continua sans le moindre répit pendant deux longues heures. Il n’augmenta ni ne diminua selon les bons ou les mauvais coups. Il se maintint au maximum, comme dans un appareil de télévision détraqué, bloqué au « son » le plus haut. VAINCRE PAR AMOUR! ABATTRE PAR AMOUR! VAINCRE PAR AMOUR!
Au bout d’une quinzaine de minutes, je n’en pouvais plus. J’étais devenu presque aphone. On insista pour qu’au moins je fredonne la rengaine.
D’autres recrues s’efforçaient de tenir bon, mais dans leur supposé chant se glissaient de plus en plus de « couac » peu harmonieux.
Je n’essaierai pas de faire saisir l’ampleur du phénomène par une comparaison avec les camps d’été où j’ai passé une partie de mon adolescence. Il y a une trop grande disproportion. Je demeurerais encore bien loin de la réalité en disant: les chahuts les plus forts, aux moments les plus pathétiques, dans les camps d’été, ressemblaient aussi peu au charivari de Boonville qu’un terrain de jeu à un champ de bataille. Mon ahurissement devint tel qu’à certains moments le sol lui-même me parut s’incliner et chavirer comme un bateau en plein naufrage.
Comme plusieurs autres techniques de la secte, ces criailleries soutenues avaient pour but d’écarter toute distraction possible. On voulait tout simplement nous empêcher de réfléchir. N’aurions-nous pas couru le risque d’entretenir des pensées négatives et improductives au sujet de la vie au camp? Toujours pour maintenir notre concentration sur un ensemble bien délimité d’idées et d’impressions, on nous invita, au retour de la partie de baseball, lorsque notre camion s’embourba dans le chemin détrempé, non pas à donner un coup de main, mais bien à continuer à pied pour ne pas déroger aux exercices prévus au programme. On laissa les responsables s’occuper du dépannage.
Un novice moonie, Geno, essaya de m’expliquer les avantages des chants prolongés:
— J’avais l’habitude, me dit-il, de détester le vacarme aux parties de baseball. Maintenant, je vois combien ces exclamations sont bienfaisantes. Je n’ai plus de distractions. Cela me permet de me consacrer à 100 p. cent au Projet… J’en suis même venu à aimer le tapage.
Heureusement, un instant inespéré de détente me fut accordé vers le milieu de cette fameuse partie de baseball. Je venais de frapper un coup sûr et je contournais le deuxième but. Les acclamations se firent encore plus bruyantes, si possible. Comme je courais, j’aperçus mon « Jack Nicholson » à qui je n’avais pas réussi à parler depuis notre arrivée. Durant une fraction de seconde, je plantai mes yeux dans les siens. Il hocha la tête et, tandis que je me lançais vers le troisième but, il me cria un seul mot, mais combien réconfortant:
— Bi-zarrrre!
Même la nuit, les activités se poursuivaient à Boonville. Des gens arrivaient et partaient, à bord des véhicules de la ferme. Dans le Palais des poulets, des ombres allaient et venaient sur la pointe des pieds. Malveillant, je les comparais à des vampires circulant dans des cimetières. Au matin, j’ai pu constater qu’au moins le tiers des lits avaient changé d’occupants.
Quand les couplets de la chanson-réveil déchirèrent le voile léger de mon sommeil, je décidai que cette journée commençante serait ma dernière à Boonville.
La veille, le menu du souper, comme celui de tous les autres repas, était composé de plats à base d’amidon, avec seulement des soupçons de protéines. Une dame, Virgina Mabrey, une ancienne cuisinière du camp, m’a confié plus tard qu’en son temps le budget prévoyait un coût de 50c par jour, par personne, pour les trois repas. En ce domaine, les choses n’avaient guère changé.
Après le souper, comme le premier soir, il y avait eu une espèce de soirée d’amateurs. Le sympathique Keith, « l’homme des montagnes », avait présenté une désopilante chanson, très populaire, disait-il, en son village. Le texte, avec son titre anglais, était plein de joyeuses assonances: « A frog on a log in a bog in the fog ». Malgré la drôlerie de tout le numéro, les vrais Moonies n’avaient applaudi qu’avec la plus grande réserve, eux pourtant si tapageurs d’habitude.
La soirée s’était clôturée par une activité imprévue: une prière collective à Notre Père des Cieux. Les recrues, nous dit-on, pouvaient ou bien participer à cette supplication, ou bien s’abstenir, mais à condition de respecter les croyances des frères et sœurs.
Pour nous éviter une trop forte surprise, Bethie nous avait préparés d’avance à cette initiative nouvelle. Elle avait déclaré:
— Même si vous ne croyez pas en Dieu, vous devez admettre un ensemble de valeurs absolues, immuables, éternelles… Nous utilisons le mot Dieu pour désigner cet ensemble. Si bien qu’en réalité la prière se ramène à une conversation avec soi-même.
Étrange conclusion! Par une pirouette mentale, Bethie venait de vider la notion de Dieu de son contenu religieux. Elle avait d’ailleurs utilisé le même stratagème tout au long de la journée. Ainsi, elle avait dé-sacralisé l’idée de Messie. D’après elle, un Messie c’était « un homme qui comprend les forces en jeu dans l’histoire et qui canalise ces forces vers un but unique ». En raison de cette définition, on pouvait qualifier de messies des génies comme Gandhi, Bouddha, Mao.
Sous l’influence de Bethie, j’en étais venu à utiliser indifféremment les mots amour et service pour désigner la même réalité. De même, l’expression un monde meilleur m’était devenue si familière que j’avais l’impression de m’en être servi toute ma vie.
Heureusement, à cette étape de mon aventure, j’avais déjà développé quelques petits trucs pour ne pas perdre complètement la tête. Par exemple, afin d’éviter qu’on me prenne les mains pendant les acclamations, je saisissais un livre de chant, je l’ouvrais et je le tenais devant un frère ou une sœur de façon à lui permettre de mieux suivre les notations musicales. Ce geste où « je contrôlais mon égoïsme » me donnait la jouissance d’au moins une main libérée pendant une demi-heure.
Par ailleurs, de bons yeux et des réflexes rapides me permettaient de prendre une salière, une poivrière ou un sucrier avant que cinq Moonies au zèle infatigable ne le fassent pour moi. Enfin, j’éprouvais un intense plaisir à fredonner pour moi-même, sur des airs connus… et en silence, des ritournelles comme celle-ci:
Ha! Ha! vous ne m’aurez pas!
Je tiendrai le coup!
Hé! Hé! Je résisterai!
Comme un âne bûté,
Je refuse de faire un pas!
Après coup, tout ceci peut paraître d’un ridicule consommé. Toutefois, au moment même, ces subterfuges et d’autres du même genre m’aidèrent à résister aux forces qui tentaient de me jeter, mains et pieds liés, dans une anonyme collectivité. Malgré tout et en dépit de mes préventions, il m’arriva d’être secoué de doutes.
— Tout bien considéré, me suis-je dit par moments, les Moonies n’ont-ils pas raison? Ne suis-je pas un pauvre type cynique, blasé, négatif? Ne devrais-je pas m’abandonner au courant et voir où il mène? N’ai-je pas toujours été du genre « journaliste neutre » qui refuse systématiquement de s’impliquer?
Un souvenir resté terriblement vivant finissait toujours par conjurer pareille séduction. Je revoyais Benji au restaurant, sa figure livide, ses yeux sans âme, sa démarche de vieillard. Comme un feu rouge clignotant, cette vision me rappelait l’abîme où je tomberais si je n’offrais pas à cette insidieuse propagande une résistance acharnée. Plus que jamais je vis l’importance de lutter pour garder mes droits à des moments de solitude et de réflexion. Comment parvenir autrement à peser le pour et le contre, à apprécier les avantages et les inconvénients, à séparer l’ivraie du bon grain, à prendre de judicieuses décisions?
De temps à autre, mes pensées désordonnées s’entrechoquaient comme des vagues dans une tempête, submergeant mes raisonnements habituels. Autour de moi, des jeunes, normaux, et même brillants, chambranlaient sous les techniques de l’endoctrinement, perdant tout sens critique. Même des gars à l’esprit vigoureux et au gros bon sens comme Nicholson et Keith devinrent de plus en plus songeurs et pensifs au cours de la conférence finale, au terme de la deuxième journée.
À l’aide de tableaux et de graphiques, avec un lot de citations impressionnantes, la conférencière résuma l’histoire de l’humanité en périodes de noirceur et de lumière. En conclusion, elle présenta notre aujourd’hui comme le point le plus élevé jamais atteint par la lumière. Comment ne pas s’émerveiller, dit-elle, devant les découvertes technologiques qui ont permis l’escalade jusqu’à un sommet? Des hommes ont marché sur la Lune; tout le monde a la chance de s’instruire; les moyens de transport relient les plus lointains villages aux grands centres; la radio, la télé, les satellites mettent les pays du globe en communication instantanée entre eux. Les États-Unis sont la Mecque du monde, San Francisco est la Mecque des États-Unis. Tout mouvement mondial qui veut réussir doit partir d’ici…
Bethie s’arrêta dans sa brillante démonstration pour poser une question:
— Christophe Colomb savait qu’il pourrait traverser l’Océan. Qu’a-t-on dit de lui?
— Qu’il était un fou! répondirent en chœur les Moonies auxquels se joignirent plusieurs recrues et même, à ma grande surprise, le brave Nicholson.
Bethie reprit:
— Nos ancêtres aussi étaient des fous. Ne prétendaient-ils pas pouvoir franchir les montagnes Rocheuses? Imaginez… les montagnes Rocheuses! Il fallait avoir le cerveau dérangé pour se lancer dans une entreprise aussi téméraire… Eh bien! c’est ce genre de folie qui nous anime ici, en ce camp… Le vrai nom de cette démence c’est ESPÉRANCE… Nous allons changer le monde et le rendre meilleur…
« YA — A — AYYYY! »
On eut l’impression qu’une force à très haute tension faisait vibrer la salle. Je me sentais moi-même comme traversé par un courant extraordinaire d’énergie et presque prêt à donner mon adhésion à ce fol idéalisme. Il faut se souvenir que nous vivions sous une intense pression depuis près de 48 heures. Dans une clarté crépusculaire, nos esprits vacillaient, confus, incertains. Tout était possible.
« C’est si simple! », murmura près de moi une jolie brunette, conquise au mouvement depuis plusieurs semaines. « Si simple! » D’autres venaient d’entendre la même conférence pour la 200e fois peut-être et pourtant ils affirmaient y avoir encore trouvé des suggestions nouvelles, stimulantes.
Bethie nous invita ensuite à nous recueillir dans une prière commune et à chanter en chœur. Surprise! Elle proposa à l’assemblée « America, America ». Je vis les yeux se fermer, les bouches s’ouvrir, des larmes couler le long des joues. Sauf Keith et moi, tous gardèrent leurs yeux fermés. A mon côté, mon ombre, Bruce, priait avec une ferveur d’une grande intensité. Il était encore recueilli quand une mouche se posa sur sa lèvre inférieure, entra sans se presser dans sa bouche ouverte, y resta douze secondes bien comptées, ressortit et s’envola. Bruce n’avait pas bronché.
Les Moonies profitèrent de ces instants de grande émotivité et de moindre résistance pour suggérer avec insistance aux recrues de rester « juste une journée de plus ».
— Vous vous devez à vous-mêmes, dirent-ils, de compléter une si merveilleuse expérience. Après tout, qu’avez-vous d’autre à faire qui soit si important, si urgent?
On promit à Keith une situation comme ouvrier agricole sur la ferme. On me promit un poste de journaliste dans une publication qui allait être lancée incessament. Je n’ai pas su ce qui fut promis aux autres recrues. Ce que je savais, pour l’avoir entendu d’anciens Moonies, c’est qu’on choisissait ce moment psychologique pour multiplier les promesses les plus mirobolantes, fussent-elles mensongères. Pour les rendre plus attrayantes, on se basait sur les confidences échangées lors des « partages ».
Le professeur désillusionné trouverait un tout autre milieu (encore à créer) dans les écoles du Projet… Au célibataire, on laissait entrevoir la rencontre (illusoire) avec l’âme sœur… À chacun on promettait la chaude sympathie d’amitiés durables…
— La musique rock vous intéresse-t-elle? Notre orchestre saura combler vos désirs. Si vous êtes un adepte des régimes à base d’aliments naturels, notre ferme répondra sans difficulté à vos exigences.
Tony Gillard m’avait mis en garde: « Ils vous promettront même la lune dans l’espoir de vous amadouer et de vous garder. »
En dépit de toutes les cajoleries et malgré ma vive curiosité, j’ai décidé de ne pas rester plus longtemps. Des ex-Moonies m’avaient décrit ce qui arriverait aux imprudents qui accepteraient « juste une journée de plus ». Ils seraient placés dans une sorte de wagon de fret psychologique, puis aiguillés sur une voie aussi inexorable que les rails parallèles d’un chemin de fer. Je ne voulais pas courir un risque aussi tragique.
Qu’arrivait-il après la journée supplémentaire à Boonville? Cela aussi je le savais grâce aux renseignements que m’avaient fournis des ex-membres. On convaincrait les trop naïves recrues d’accepter une nouvelle proposition. Elles iraient participer à un séminaire de cinq jours dans un autre endroit éloigné, le camp K. Là, un conférencier-étoile leur expliquerait « 3 000 ans d’histoire » d’une façon si « claire » qu’elles en seraient plongées dans le plus agréable émerveillement devant cette nouvelle et fulgurante vision qu’elles auraient de la vie.
Plus les jours s’ajouteraient aux jours, plus les méthodes de contrôle se durciraient. Ainsi, dès les premières notes du chant de réveil, les recrues devraient bondir de leur lit. Le soir, dès que leur tête toucherait l’oreiller, elles devraient s’endormir. Et ainsi de suite. Pour qu’elles se soumettent à ce régime austère, on n’aurait pas à leur donner des ordres. Il suffirait de leur rappeler que si l’on est le centième dans un groupe, il n’est peut-être pas bon de se comporter autrement que les 99 autres.
On me l’avait dit également, les recrues mettraient plus de force dans leurs chants et leurs acclamations. À l’occasion, elles se priveraient volontiers de nourriture et de sommeil pour imiter les 99 autres. Les entraîneurs leur enseigneraient des techniques d’auto-hypnotisme, supposément pour accroître leur pouvoir de concentration, en fait pour oblitérer toute pensée critique. Elles apprendraient à se répéter à voix très basse: « VA-T’EN! VA-T’EN! VA-T’EN! » pour repousser les idées négatives qui tenteraient de s’imposer à leur psychisme. La suppression progressive des distractions ainsi assurée, elles se soumettraient à une technique qui, à plus ou moins longue échéance, altérerait et même métamorphoserait leur personnalité.
A cette époque, j’ignorais la nature exacte de tous les éléments de cette technique. Mais les anciens membres à qui j’en ai parlé les ont toujours évoqués devant moi avec une stupeur et une crainte révérentielles. On m’a dit que, d’une façon ou d’une autre, chacune de ses composantes faisait glisser la réalité de quelques degrés. L’isolement, le manque de sommeil et de protéines, les perpétuelles confessions et l’absence de temps pour réfléchir amenaient peu à peu les recrues à perdre les pédales. Ainsi, elles ne restaient pas au camp en vertu d’une volonté explicite. Tout simplement, elles remettaient sans cesse à plus tard la décision de partir.
Aux recrues qui restaient assez longtemps, on inculquait peu à peu des principes religieux. On les entraînait à se brancher sur la grande FORCE de l’univers. Puis, au bout de deux à six semaines, ou plus tard encore, quand les néophytes étaient psychologiquement prêts, on leur mentionnait le nom de Moon. Les semaines suivantes, Moon et sa doctrine occupaient une place de plus en plus importante dans les conférences. Si bien qu’un jour, comme dans une illumination soudaine, les jeunes novices reconnaissaient en Moon un Messie. Et leur Maître. À ce moment-là, ils devenaient d’authentiques Moonies.
Les techniques d’endoctrinement utilisées à Boonville engagent-elles la personnalité dans une évolution fatale et irréversible? Non, mais à la condition d’introduire dans le mécanisme un élément étranger, et ce dès les premiers stades de l’endoctrinement.
A la fin de mon deuxième et dernier jour à Boonville, je remarquai que plusieurs recrues — même Nicholson! — acceptaient de rester « une journée de plus ». Je décidai alors d’intervenir. Au cours de la discussion qui suivit la toute dernière conférence, j’ai demandé carrément à Bethie quel était le grand patron du Projet. Embarrassée, elle répondit que, entre autres, il y avait comme inspirateurs Jésus, Bouddha et le psychiatre Maslow. Je demandai des précisions. Bien à contrecœur, Bethie avoua que l’enseignement donné à Boonville s’apparentait parfois à la doctrine de Moon, mais elle s’empressa de donner des explications qui, selon le programme, n’aurait dû venir que deux ou trois semaines plus tard.
— Moon, dit-elle, est un homme intéressant qui est l’objet d’attaques déloyales… tous les grands hommes furent persécutés à tel point qu’on se demande si quelqu’un à qui les incompréhensions furent épargnées mérite d’être écouté…
Avec son intuition féminine, Bethie perçut immédiatement que sa réponse, même atténuée par des commentaires édulcorés, pouvait avoir des effets désastreux. Elle se hâta de faire marche arrière.
— D’aucune manière, déclara-t-elle, le Projet n’est relié à Moon. On accepte au camp seulement quelques bribes de sa doctrine.
Il était trop tard. Bethie ne pouvait plus réparer son faux pas. Le chat était sorti du sac trop tôt. Le seul nom de Sun Myung Moon, bien connu sur la Côte ouest, avait suffi pour effaroucher les recrues.
Nicholson ne tarda pas à déclarer qu’il s’en allait. Pendant plus d’une demi-heure, Bethie essaya de le dissuader. Peine perdue. Nicholson était décidé à partir même s’il lui fallait faire de l’auto-stop jusqu’à San Francisco. Comme il se dirigeait vers la sortie, il me souffla:
— Merci pour la dernière question, l’ami.
Un autre type le suivit bientôt. C’était plus grave, car le gars terminait son cinquième jour à Boonville et s’apprêtait à signer l’engagement d’une semaine pour le camp K. Lui aussi refusa les explications entortillées de Bethie.
Une vraie débandade s’amorçait. L’une après l’autre, les recrues partaient malgré les cajoleries et les supplications des Moonies. Le négativisme avait réussi à s’insinuer à Boonville et rien ni personne ne pouvait l’en chasser. Du moins ce soir-là.
Bientôt, il n’y eut plus que deux recrues à rester: Keith et moi.
Je reçus alors un appel téléphonique. Marilyn et moi l’avions planifié avant mon départ pour le camp. Tel qu’entendu, ma compagne de voyage m’annonçait que mon père était tombé gravement malade. C’était faux, bien sûr, mais c’était une bonne excuse pour filer à l’anglaise. Comme j’allais préparer ma valise, Keith me fit un clin d’œil et me suivit.
Quelques minutes plus tard, comme nous marchions tous les deux vers la sortie, les Moonies nous chantèrent une sérénade d’adieu. Bethie nous donna à chacun une chaleureuse accolade tout en nous suppliant une dernière fois de rester.
Je regardai ses beaux yeux bleus et son sourire enjôleur. Je regardai les autres Moonies, chantant pour nous et nous saluant d’un geste amical. Pendant quelques secondes — des secondes insensées — , je fus ému au point d’hésiter dans ma détermination.
Brusquement, je tournai sur mes talons et, accompagné de Keith, je marchai en direction de la sortie. Pendant que je m’en allais vers l’autoroute la plus proche, je n’avais plus qu’une idée en tête. Je me disais: si Benji a vécu cinq mois à Boonville, je n’ai pas à me demander pourquoi il est maintenant méconnaissable à tous points de vue.

▲ Sun Myung Moon et Hak Ja Han
Chapitre V
À notre retour à Montréal, deux jours plus tard, une tâche nous attendait, la plus pénible de toute notre vie: Marilyn et moi devions mettre les parents de Benji au courant de la tragique situation où se trouvait leur fils. Durant nos deux semaines en Californie, les Miller avaient téléphoné à plusieurs de nos amis pour avoir des nouvelles. Personne n’avait parlé de notre tentative, dans l’espoir que nous ramènerions Benji. Étant donné notre échec, il fallait tout révéler. Le lendemain de notre retour, nous invitions donc les Miller à se rendre chez Lenny et Janet. Nous les y rencontrerions.
Libby Miller, la mère de Benji, était une femme affable et volubile, le type même de la mère standard. Grande et jolie, avec des cheveux blonds et un teint clair, elle travaillait à temps partiel dans un magasin d’équipements de camping. Elle s’occupait aussi à des œuvres de bienfaisance, mais le gros de son dévouement et de ses préoccupations allait à ses trois enfants: Janice, un adolescent dégingandé qui se préparait à entrer au collège, Debbie qui s’entraînait en Europe en vue d’une carrière de pianiste virtuose, et Benji — le plus âgé et le plus indépendant — que sa mère désirait voir casé: marié et lancé dans une brillante carrière.
Chaleureux, enjoué, Charles Miller — Charlie pour les amis et les membres de la famille — était aussi typiquement père que son épouse était mère. Il réussissait bien dans l’industrie de la mode où sa compétence était reconnue. Un peu chauve et légèrement bedonnant, il esquissait un sourire espiègle permanent. Son stock d’histoires drôles était inépuisable. Avez-vous déjà remarqué, disait-il, comment un leader syndical commence à raconter une histoire? « Il était une fois et demie… »
Les Miller furent ponctuels au rendez-vous. Lui avec veston et cravate. Elle dans une fort élégante robe blanche. Et, comme nous l’avions prévu, ils apportaient un gâteau au café — auquel on ne toucha pas de la soirée.
Avec toute la délicatesse possible, nous avons raconté notre aventure, depuis le départ et le retour de Mike jusqu’à mon séjour mouvementé à Boon-ville. Notre récit les affecta, bien sûr, et très profondément. Mais sans les surprendre tout à fait. Depuis longtemps déjà, ils redoutaient le pire. Les lettres étranges et de moins en moins nombreuses de Benji, ses appels téléphoniques courts et froids avaient déjà déclenché chez eux de sourdes appréhensions.
— Tout était si mystérieux, rappelait Mme Miller. Benji parlait d’un Projet grandiose, mais sans donner de détails. Toutes ses histoires de communes, de créativité, de frères et de sœurs ne nous disaient rien qui vaille.
Cette soirée fut l’une des plus tristes que j’aie vécues. Je ne pouvais, sans en avoir le cœur serré, voir ces pauvres gens se ronger d’inquiétude. Souvent leurs yeux s’emplissaient de larmes.
Les questions de Mme Miller trahissaient une anxiété bien maternelle.
— Comment Benji va-t-il? demanda-t-elle. A-t-il l’air en santé? A-t-il maigri? Comment était-il habillé? Avait-il bon teint? Semblait-il heureux?
M. Miller nous interrogeait plutôt sur des aspects pratiques du problème:
— Existe-t-il des moyens légaux de libérer Benji? Quels sont les vrais patrons dans l’organisation de Moon? Que doit-on faire concrètement pour ramener Benji?
Nous avons répondu de notre mieux à ces questions et à d’autres du même genre. Je me gardai bien cependant de livrer le fin fond de ma pensée. En vérité, je n’entretenais pratiquement pas d’espoir de jamais retrouver mon vieil ami. J’avais vu de trop près, à Boonville, la technique de persuasion qu’on avait mise en place pour douter de son inexorable efficacité. En effet, malgré mes renseignements, mes partis pris, mes préventions, à certaines heures, j’avais moi-même éprouvé un vertige hallucinant et j’avais failli tomber dans l’abîme. Tout mon voyage en Californie m’apparaissait comme un affreux cauchemar et je n’étais pas du tout tenté d’y retourner. Benji, lui, vivait dans cette atmosphère dantesque depuis des mois et des mois.
Vers deux heures du matin, les Miller s’en allèrent. En nous quittant, ils eurent la force de sourire. Mais, de la fenêtre, nous les avons vus se jeter dans les bras l’un de l’autre avant de monter dans leur voiture. Enfin, ils pouvaient pleurer tout leur soûl.
Les jours suivants, les Miller ont pris connaissance de notre dossier sur la personne et les activités de Sun Myung Moon. Ils ont communiqué aussi avec la police et des avocats de San Francisco. Ils ont pris également contact avec les forces anti-Moon dans une douzaine d’États américains. Leur zèle me stimula. Par téléphone, j’ai essayé d’en savoir plus long sur le travail du comité présidé par le républicain Donald Fraser. Où en était son enquête sur les ramifications politiques du mouvement de Moon? Mes entrées dans le monde de la presse — et aussi une chance du tonnerre — m’ont permis de rejoindre une personne clé qui me promit un lot de renseignements « pour les jours prochains ».
Mais avant même que je reçoive ce supplément d’information, les Miller m’ont confié qu’ils en savaient déjà assez sur Moon pour en arriver à une décision pratique. À leur avis, il nous fallait à tout prix retrouver Benji et nous arranger pour lui parler longuement, en dehors de toute présence suspecte. Pour atteindre ce but, une visite du genre de la nôtre ne valait rien. Comme par ailleurs tout recours légal efficace était impossible, il restait un seul moyen qui aurait quelque chance de succès: kidnapper Benji.
— Que faire d’autre? demanda Mme Miller, affolée. Peut-être est-ce un geste insensé? Pourquoi prendre une telle chance? Mais si Benji est encore et toujours notre fils, il comprendra.
Il fallait attirer Benji hors de sa retraite. Fort heureusement nous possédions l’appât nécessaire: nulle autre que Debbie, la jeune sœur de Benji, arrivée depuis peu d’Europe, en visite chez ses parents. Intelligente et studieuse, cette jeune femme de 26 ans professait pour son « grand frère » une admiration sans réserve. Elle le trouvait énergique, de commerce agréable, avec tout juste assez de fantaisie pour le rendre tout à fait sympathique.
— Je connais des douzaines de personnes, dit-elle, à qui pareille mésaventure pourrait arriver. Mais Benji! Ça, non! Je ne comprends pas qu’il soit tombé dans un tel piège. Non, vraiment!… Il faut l’en sortir.
Debbie Miller téléphona donc à son frère au quartier général, rue Washington, à San Francisco. On lui répondit que Benji était absent mais qu’il rappellerait dès son retour. En fait, il appela seulement le lendemain. Sa voix demeurait impassible, mais ses paroles indiquaient son plaisir à parler à sa sœur.
Selon le plan que nous avions élaboré tous ensemble, Debbie annonça qu’elle allait visiter une vieille amie à Vancouver. Elle aimerait, dit-elle, y rencontrer son frère. Celui-ci déclina l’invitation sous prétexte qu’il lui était impossible de quitter la Californie. Après une légère pause, il suggéra que, de Vancouver, Debbie descende le visiter. « Cela demande réflexion », dit-elle. Benji promit alors de rappeler le lendemain.
Qu’allions-nous faire?
Après délibération, il nous parut imprudent d’envoyer Debbie seule. En effet, Benji essaierait peut-être d’amener sa sœur à Boonville. Il fallait éliminer la possibilité d’un tel voyage.
Deux jours plus tard, — non pas le lendemain tel qu’il l’avait promis — , Benji rappela. Le nouveau plan était en place. Debbie dit que Mme Miller désirait l’accompagner, mais seulement pour une visite de trois jours. Elle, Debbie, demeurerait une semaine de plus. Benji pensa sans doute, comme nous l’avions prévu, que cette semaine supplémentaire lui permettrait d’amener sa sœur à Boonville. Toujours est-il que, après un instant d’hésitation, il accepta le projet tel quel et promit de recevoir ses visiteuses quatre jours plus tard à l’aéroport de San Francisco. Il avait mordu à l’hameçon!
Le soir même, réunion chez les Miller pour constituer l’équipe de l’enlèvement. On me mobilisa en tout premier lieu à cause de ma première expérience. De l’avis de tous, j’étais le plus au courant de la situation. J’acceptai à contrecœur et seulement parce que ma vieille amitié pour Benji m’y obligeait. On m’adjoignit trois compagnons: Lenny, le mari de Janet, Simon, un sympathique représentant syndical et enfin Gary, travailleur dans le monde du cinéma et lui aussi membre de notre bohème.
Équipe lamentable s’il en fut. Tous dans la trentaine, tous pacifistes, sans même une bonne bataille à coups de poings à notre crédit depuis notre high school. Avec la mise en commun de nos intelligences, nous pensions pouvoir organiser assez bien le complot de l’enlèvement. Mais qui fournirait les muscles? Notre seul espoir, c’était de trouver sur place, à San Francisco, les fiers-à-bras nécessaires pour la réussite de notre audacieuse entreprise.
À la toute dernière minute, on décida que le père de Benji, Charlie, nous accompagnerait. Ne nous serait-il pas bien précieux, une fois le rapt réussi? Il nous aiderait à calmer et à raisonner son fils.
Nous étions tous nerveux ce soir-là. Nous l’étions davantage le lendemain, en montant dans l’avion. Mon informateur de Washington m’avait téléphoné durant la nuit pour m’informer de la puissance dont disposaient Moon et ses adeptes. « Votre adversaire coréen, dit-il, exerce, dans presque tous les milieux, une influence qui dépasse largement ce que vous pouvez imaginer. »
Chapitre VI
Un jour de juin 1965, une luxueuse limousine arriva à la ferme de Gettysburgh où vivait Dwight D. Eisenhower, président des États-Unis à la retraite.
De la voiture descendit une délégation envoyée par un vieil ami de Ike, Yang You Chan, ancien ambassadeur de la Corée du Sud aux États-Unis. Dans le groupe, il y avait plusieurs jeunes danseurs coréens connus sous l’appellation «Les petits anges ». Il y avait aussi un pasteur coréen aux formes arrondies.
Bombardé par les photographes amateurs, l’ex-président dit en plaisantant:
— Vous êtes bien armés en caméras… Au fait, quel est le nom de votre mouvement?
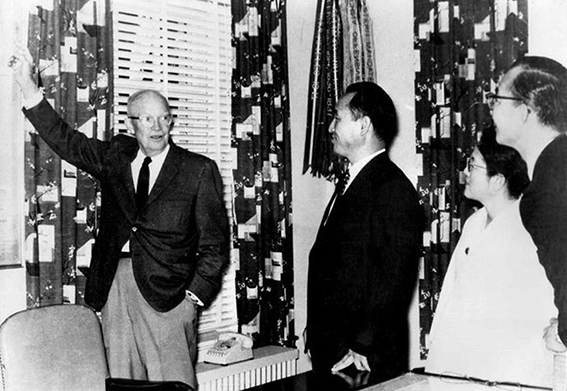
▲ Dwight D. Eisenhower, Sun Myung Moon, Won-pok Choi et Bo Hi Pak, juin 1965.
— L’Église de l’unification, répondit l’évangéliste coréen pendant que son assistant Bo Hi Pak offrait à Ike une biographie de Moon en édition de luxe.
Eisenhower feuilleta l’album. En regardant l’une des photos qui représentaient Moon en train de présider au mariage de 124 couples, «il écarquilla les yeux », si l’on en croit la publication de l’Église qui rapporta l’incident.
« Je n’ai jamais vu rien de pareil », aurait dit l’ex-président, qui passa les 45 minutes suivantes à causer aimablement avec ses hôtes, toujours selon le magazine publié par l’Église de l’unification…
Pour Ike, la visite n’avait rien de significatif. Un banal incident sans conséquences. Pour Sun Myung Moon, au contraire, la rencontre était d’une extrême importance. Le gros homme venait d’enfoncer un coin dans une fissure qui allait s’agrandir jusqu’à lui donner accès aux personnages américains les plus puissants.
Peu après cette entrevue, Eisenhower consentit à devenir président honoraire de la Korean Cultural Freedom Foundation (KCFFJ qui se présentait comme une organisation destinée à combattre le communisme et à resserrer les liens culturels entre la Corée et les États-Unis. En fait, la KCFF n’était qu’un autre prête-nom pour l’Église de l’unification.
Faisant état du prestigieux appui donné par Eisenhower, Bo Hi Pak obtint bientôt des approbations du même genre de la part d’hommes éminents comme l’ex-président Harry Truman, des douzaines de sénateurs et des membres du Congrès tels que Richard Nixon et Gerald Ford, ainsi que de personnalités bien connues, telles que Bob Hope, Bing Crosby et Ed Sullivan.
De si brillants parrainages mirent en confiance 140 000 Américains qui versèrent, bon an mal an, des millions de dollars à la KCFF pour combattre la menace rouge. Ce flot d’argent continua à couler pendant des années. Il tarit seulement en 1975 quand furent rendus publics les liens qui unissaient Moon à la KCFF.
Mais, à ce moment-là, la disparition du mouvement n’avait rien de désastreux pour le pasteur coréen. Le « Révérend » Sun Myung Moon avait bien d’autres fers au feu.
* * *
Environ un an après notre enlèvement de Benji à San Francisco, le Comité du Congrès américain présidé par le républicain Donald Fraser publiait les conclusions de son enquête sur l’empire politique de Moon. Au dire du Comité, Moon joua un rôle de premier plan dans la tentative du gouvernement de la Corée du Sud d’influencer la politique intérieure et extérieure des États-Unis. De plus, Moon s’est servi à la fois du gouvernement coréen et d’un nombre étonnant de personnalités américaines éminentes pour s’approcher de son but qui n’est rien d’autre que de « s’emparer du monde entier ».
À la lecture du rapport du Comité, plusieurs se sont étonnés de ce qu’une secte marginale, conduite par un chef souvent ridiculisé, ait pu mener de front tant d’activités. Mais nous n’en fûmes d’aucune manière surpris, nous de l’équipe de l’enlèvement. Le rapport confirmait ce que avions appris un an plus tôt ou deviné grâce à nos amis de San Francisco et à notre informateur de Washington, à savoir que, parallèlement à l’énorme organisation financière de Moon, il existe un complexe et ténébreux empire politique — toujours sous la conduite de Moon — dont on ne parviendra jamais à connaître l’étendue.
Les pages suivantes décriront les principales découvertes du Comité Fraser.
KOREAN CULTURAL FREEDOM FOUNDATION (KCFF)
Après l’acceptation par Eisenhower et Truman de devenir présidents honoraires, quatorze généraux, huit amiraux et une foule de personnalités américaines ont consenti avec plaisir à être inscrites comme aviseurs de la KCFF.
Des adhésions aussi impressionnantes ont permis à la KCFF d’orchestrer une publicité du tonnerre, à l’occasion du bi-centenaire, pour demander de l’argent à deux fins: combattre le communisme et sauver de la mort les enfants affamés de Corée. Des milliers et des milliers d’Américains tombèrent dans le piège, dont George Meany, Jack Nicklaus, Johny Unitas et le républicain Carl Albert. À eux seuls les propriétaires du Reader’s Digest ont donné à la KCFF un demi-million en dollars.
L’unique critique sérieuse vint de l’ambassade des États-Unis en Corée qui ne cessa de dénoncer la KCFF comme étant le groupe « homme de paille » de « gens aux activités louches et nauséabondes ». Mais le gouvernement américain ne voulut pas intervenir.
En 1976, une agence gouvernementale de l’État de New York examinant les livres de l’un des organismes de bienfaisance de la KCFF, The Childrens’ Relief Fund, découvrit que seulement deux pour cent de la somme recueillie, soit 1,2 million de dollars, avait été réellement employée à nourrir des enfants affamés. À la suite de cette vérification, on interdit à la KCFF de continuer ses sollicitations dans l’État de New York.
Peu à peu, le public prit connaissance des agissements de l’organisation. En 1978, les liens étroits qui existaient entre la KCFF et Moon furent exposés en pleine lumière. L’influence du groupe et ses profits en furent considérablement réduits. Néanmoins, Bo Hi Pak dirige encore la KCFF tout en proclamant qu’elle n’est en rien reliée à Moon.
La KCFF donna naissance à plusieurs filiales dont « Les petits anges », troupe de jeunes danseurs coréens qui fit merveille pour accroître le prestige de Moon. Après l’avoir organisée en 1962, Moon la confia à la KCFF.
Moon espérait que la troupe exercerait une influence en sa faveur jusque dans « les palais des rois et des reines ». Il y est presque parvenu. Les Petits anges ont été reçus en audience privée par la reine Elizabeth au palais de Buckingham. Ils ont été le premier groupe culturel à apparaître devant les Nations unies. Ils ont joué avec des artistes-étoiles comme Sammy Davis Jr. et Liberace, dans des salles de concert comme Carnegie Hall et d’autres en Afrique. Ils ont même enregistré avec MGM.
Les concerts donnaient à Moon l’opportunité de se faire photographier avec des politiciens et des diplomates. Ces portraits s’ajoutaient au matériel de publicité qui le montrait comme une sommité mondiale, entourée d’amis très puissants.
Un autre projet de la KCFF, conçu celui-là par Bo Hi Pak, fut la Radio Free Asia (ROFA) destinée à renseigner « les populations souffrant derrière le rideau de bambou ». L’organisme recueillit des millions de dollars jusqu’en 1975. Cette année-là, quand le public sut quels liens étroits unissaient la ROFA au gouvernement coréen et à Moon, les dons cessèrent et l’organisme disparut.
FREEDOM LEADERSHIP FOUNDATION (FLF)
Par la FLF, l’Église exerce une action politique aux États-Unis. Enregistrée comme une organisation éducationnelle sans but lucratif, elle a pour but officiel de former des chefs dans le combat contre le communisme.
Quand la FLF fut fondée vers la fin des années 60, elle suscita des protestations chez des membres Moonies de la première heure venus des milieux de gauche, malgré qu’on leur eût expliqué que le mouvement religieux avait pour but d’exercer une influence sur le milieu politique. « Ces membres furent rapidement dénoncés et expulsés pour leur infidélité au Maître et leur désobéissance à Dieu », rappelle Allen Tate Wood, président de la FLF en 1970, l’un des plus importants renégats du mouvement.
On pouvait lire sur les feuillets de propagande de la FLF: « La Corée du Nord veut déclencher une nouvelle guerre. Les États-Unis ont le devoir sacré de défendre la Corée du Sud contre une agression communiste. »
Pareille attitude, en plus de rendre davantage Moon persona grata auprès du gouvernement de la Corée du Sud, lui gagna de nouvelles sympathies chez d’éminents Américains. Ainsi, dans la publicité de la FLF, on pouvait voir à l’époque des photos de Moon avec des personnages tels que Ike, Humphrey, Thurmond, Kennedy, Nixon.
Des sections FLF furent établies dans 40 pays sous l’appellation de Victory Over Communism (VOC). Au Japon, l’organisme mena campagne aux élections pour les candidats de droite. Au Vietnam, il monta des unités hospitalières mobiles. En Corée du Sud, il fonda le World Freedom Institute, un centre d’endoctrinement anticommuniste où, même aujourd’hui, les fonctionnaires et les officiers de l’armée doivent aller se recycler.
Le président actuel du FLF, Neil Salonen, prétend que l’organisme a un caractère plus religieux que politique dans sa lutte anticommuniste et le support qu’il fournit à la Corée du Sud. « Nous ne sommes pas un groupe de pression, dit-il, nous éduquons. »
L’une des activités les plus originales du FLF se déroula sur la colline du Capitole jusqu’en 1977, grâce à une équipe de jeunes et jolies Moonies. Elles étaient une vingtaine à intriguer auprès du personnel gouvernemental en faveur des mesures jugées opportunes par Moon.
Le sénateur de New York, Israël Ruiz, se rappelle en avoir rencontré, de ces sirènes, au festival God Bless America organisé par Moon en 1976.
— Très charmantes, dit-il, elles vous mettaient rapidement à l’aise. Elles vous envoyaient des fleurs… Je n’ai jamais vu des propagandistes aussi efficaces.
Moon n’a jamais caché le but de ce genre de lobby. Dans ses discours, il disait par exemple: « Le Maître a besoin de trois cents belles jeunes filles. Il en assignera trois à chaque sénateur… histoire de dominer les plus faibles. S’il se trouve parmi les sénateurs et les membres du Congrès des gens opposés à nos objectifs, nous les remplacerons par des membres de notre Église. Tel est notre rêve… Mais que tout se fasse discrètement. Agissez… Il nous faut établir une théocratie pour gouverner le monde. »
L’équipe des lobbyistes loua un appartement à l’hôtel Hilton de Washington et y invita les sénateurs et les membres du Congrès les plus malléables. Bien entraînées, les jeunes filles n’hésitaient pas à employer les stratégies tortueuses qui sont monnaie courante chez les Moonies. Leur devise: « Allier la ruse du serpent à l’innocence de la colombe. » « C’était très efficace, dit l’une d’elles. Avec un peu d’habileté et de la persévérance, nous faisions de ces gens-là des amis et des alliés. »
Au moins deux jeunes filles, Sherry Westerledge et Susan Bergman, travaillèrent auprès des membres du Congrès jusqu’en 1979, tout en logeant aux quartiers généraux de l’Église et tout en remettant leur salaire à la caisse commune.
Alors qu’elle était au service du républicain Doug Hammerschmidt, Mlle Bergman attira l’attention, en 1976, par ses curieuses relations avec l’ancien président de la Chambre, Carl Albert. Jolie, les yeux en amande, Mlle Bergman apportait des fleurs à Albert chaque matin, lui préparait du thé ginseng et l’accompagnait ensuite sur la colline du Capitole. Aux critiques, Albert répondait: « Elle est seulement une jolie fille, une très jolie fille, une belle juive de New York. Elle est entichée de Jésus et veut me gagner à lui. Je pense qu’elle cherche à me convertir. Que trouve-t-on à redire à cela? »
Le travail des lobbyistes facilita à Moon ses entrées au Capitole. Ainsi fut-il invité à une réunion de prières en son honneur, à la salle des Caucus, par deux membres du Congrès, Bill Chappell et Richard Ichord. Moon arriva dans une étincelante Lincoln noire et fut accompagné par des gardes du corps jusqu’à la salle des Caucus. Selon le magazine Time, le républicain Ichord se dit alors « profondément impressionné et compara le pasteur millionnaire à Moïse, Jean-Baptiste et Jésus ».
Les jolies lobbyistes ont mis fin à leurs activités à Washington à la fin de 1977. Mais plusieurs d’entre elles font maintenant partie des équipes de propagandistes qui se promènent à travers le pays pour expliquer l’Église et ses principes à des politiciens locaux, à des étudiants d’université et à des hommes d’affaires.
OPÉRATION WATERGATE
La plus connue des activités politiques de l’Église demeure l’effort accompli pour sauver Nixon durant le scandale Watergate.
Surnommée Projet Archange Nixon, la campagne commença en novembre 1973 par une annonce d’une pleine page parue dans les journaux de 21 cités, où l’on invitait les lecteurs « à pardonner, à aimer, à s’unir… Dieu a choisi Richard Nixon… Nous devons aimer le président des États-Unis. » Ces annonces furent suivies par un jeûne et des prières, pendant quarante jours, sur les marches du Capitole. De leur côté, les lobbyistes féminines à Washington obtinrent les signatures de quatre sénateurs et de 28 membres du Congrès.
Le 14 décembre, le secrétaire de Nixon invita Moon et son comité Watergate à la cérémonie de l’arbre de Noël à la maison Blanche. Douze cents Moonies répondirent à cette invitation et se livrèrent à une démonstration impressionnante en faveur de Nixon. Des documents obtenus par le Comité Fraser démontrent que cette manifestation avait été préparée jusque dans ses moindres détails. Les chefs Moonies, par exemple, avaient dit: « Attention! Sur les photos, les prières discrètes impressionnent davantage… Les prières trop expansives paraissent mal… Durant les cantiques, ne serrez pas les poings… Attention! »
Le soir, les Moonies revinrent pour une veille à la chandelle. Tricia Nixon et son mari Edward se mêlèrent a la foule et remercièrent tout le monde.
Des démonstrations du même genre furent organisées par les Moonies dans d’autres villes des États-Unis ainsi qu’au Japon, en Allemagne, en Italie et en Angleterre.
Le 1er février 1974, Moon fut invité par le bureau du président au déjeuner annuel préparé par la Maison Blanche pour les chefs religieux du pays. Après la réunion, Moon causa privément avec Nixon dans le célèbre bureau Ovale. Il aurait, paraît-il, donné une accolade au président et prié pour lui en coréen.
Quelques mois plus tard, Moon aurait déclaré à ses amis: « Si Nixon sort vainqueur de cette épreuve, le nom de Moon jouira alors d’un renom et d’une popularité universels. »
Dernier détail. Les lobbyistes avaient aussi comme mission de tenir à jour une fiche sur la personnalité et les activités des membres du gouvernement américain.
À quelles fins?
Une ex-Moonie m’a dit: « C’était, paraît-il, afin de servir les intérêts de la Mission, avec un grand M. Je n’ai jamais su quelle était la nature de cette mission. Je me contentais d’obéir. »
INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE UNITY OF SCIENCES (ICUS)
L’ICUS est un congrès annuel où Moon invite des centaines de savants du monde entier pour étudier les Valeurs absolues.
Moon n’épargne rien pour que la réunion soit fastueuse. Il paie les voyages de ses invités et toutes leurs autres dépenses. La facture s’élève d’ordinaire à environ 500 000$. Certains refusent de venir lorsqu’ils apprennent que le congrès est organisé par Moon, mais la plupart n’en sont aucunement ennuyés.
En 1978, la réunion annuelle de l’ICUS eut lieu dans les jours qui suivirent le suicide collectif des gens du People’s Temple en Guyane. Malgré cette tragédie, 90 p. cent des invités répondirent à l’invitation de Moon, dont quatre Prix Nobel et des sommités comme Paolo Soleri, Karl Pribham et Kasim Gulek, l’ancien premier ministre de Turquie.
Sur le trottoir en face de l’hôtel, des contestataires portaient des écriteaux sur lesquels on pouvait lire: « Quelle est votre morale? Quelles sont vos valeurs? »
Dans les grands salons de l’hôtel, on traitait de sujets aussi variés que les problèmes de santé dans l’Ouest africain et les aspects étiologiques et immunologiques du cancer nasopharyngien. Dans l’un des ateliers, l’on discuta du suicide dans les philosophies contemporaines. Pendant la session qui dura deux heures et demie, il ne fut d’aucune manière question de la toute récente tragédie de la Guyane en dépit du fait que plusieurs journaux, étalés dans la salle, parlaient du chiffre effarant de 775 victimes. Au lieu de cela, les savants se sont penchés sur les suicides romantiques de Socrate et de Sylvia Plath. L’étude principale, présentée par Joyce Carole Oates, portait sur l’art du suicide.
Comme le Prix Nobel de physique, Eugene Wigner, la plupart des participants n’ont eu aucune objection à ce que le congrès soit commandité par Moon. D’autres n’ont pas hésité à formuler des louanges expresses. Tel le sociologue du MIT, Daniel Lerner, qui fit carrément l’éloge des Moonies. « Ils sont, dit-il, parmi les meilleurs des jeunes d’aujourd’hui. »
Plusieurs centaines de Moonies se sont amenés au congrès dans des autobus étiquetés Aboji Monsei (Victoire pour le Père). Comme s’ils s’étaient adressés au même tailleur et au même coiffeur, les jeunes avaient tous même apparence. Bien soignés de leur personne, ils écoutaient les discours avec intérêt tandis que leurs chefs se mêlaient aux personnages importants. Dans son livre Master Speaks, Moon explique: « Si nous invitons ces savants, c’est pour qu’ils soient impressionnés par nos recrues. Ils voudront ensuite que leurs étudiants reçoivent le même entraînement. Bientôt nous exercerons une grande influence sur les États-Unis par l’entremise de ces intellectuels… Dans un avenir prochain nous inspirerons les politiques de tous les pays. »
Le Comité Fraser regarde l’ICUS comme une partie de la stratégie globale de Moon pour contrôler les plus grandes institutions du monde. Moon se propose de convoquer un congrès mondial pour les économistes, un autre pour les politiciens, un autre enfin pour les mass media. Il veut aussi élaborer un système de prix, genre Prix Nobel et fonder une université. Pour cette dernière, le terrain où elle s’élèvera est déjà acheté.
KOREAN KCIA CONNECTION
Y a-t-il quelqu’un derrière Moon? Représente-t-il de plus hauts intérêts? Croit-il sérieusement être le Messie?
Plusieurs ex-Moonies pensent que Moon est convaincu d’avoir une mission messianique. Cette opinion s’appuie sur le comportement personnel de Moon et sur la qualité flamboyante de ses discours.
De son côté, Bo Hi Pak, bras droit de Moon et son agent de liaison avec le gouvernement de la Corée du Sud, semble un authentique croyant. Au dire de Judy Stanley, Pak a inscrit son propre fils au programme des 100 jours d’entraînement à Barrytown, la journée même de ses seize ans. Plusieurs autres chefs, surtout aux échelons inférieurs, paraissent convaincus à fond.
Mais la religion ne suffit ni à Moon ni à Pak. D’après le comité Fraser, ils sont les grands inspirateurs du gouvernement coréen dans ses tentatives d’influencer les États-Unis.
Don Ranard, ancien directeur de la section des affaires coréennes au Département d’État, m’a dit un jour: « Moon et Pak savent ce qu’ils veulent. Ils ont des amis dans les hautes sphères du gouvernement américain et ils représentent plus que l’Église de l’unification. »
Pour comprendre les attitudes politiques de Moon, il faut savoir ce qui s’est passé en Corée depuis qu’en 1961 Park Chung Hee a renversé le gouvernement constitutionnel pour y installer une dictature militaire.
Pour se maintenir au pouvoir, le régime Park pouvait compter sur l’omniprésente KCIA, décrite par un fonctionnaire du Département d’État comme « un État dans l’État, un monde de bureaucrates, d’intellectuels, de bandits et d’aventuriers ».
Établi en 1961 avec l’aide de la CIA américaine, la KCIA s’est acquis la réputation d’être l’une des forces policières les plus brutales du monde. Comptant environ 50 000 employés, hommes et femmes, la KCIA contrôle rigoureusement tous les aspects de la vie en Corée. Rien n’est imprimé, rien ne passe sur les ondes sans son approbation. Les politiciens, les chefs de syndicats, les officiers du gouvernement, les membres du clergé et les étudiants sont tous surveillés. Quand ils dévient de la ligne droite, ils sont arrêtés, battus, tués.
Telles sont les eaux boueuses d’où Moon a émergé, propre, intact, correct. Bien qu’imprécises, ses relations avec le gouvernement sont, de toute évidence, excellentes. En conséquence, plusieurs critiques accusent Moon de directe complicité avec la KCIA. Pak n’y voit cependant que « vengeance, basse calomnie et déformation de la vérité ».
Dans son rapport, le Comité Fraser n’affirme pas que Moon soit un agent du gouvernement sud-coréen, mais il parle d’une « étroite collaboration » entre l’un et l’autre. Moon ne fut jamais entravé par le gouvernement dans ses activités. Au contraire, il en a souvent reçu une aide considérable. En retour, il travaille constamment pour le gouvernement, et parfois sous ses ordres.
En employant les mots mêmes de l’ancien président du FLF, Allen Tate Wood, les buts de la KCIA et de l’Église de l’unification se chevauchent au point de ne présenter aucune différence.
Les relations de Moon avec la KCIA ont commencé en 1962 alors que le premier chef de la police clandestine coréenne, Kim Chong-Pil, rencontra secrètement un petit groupe de Moonies nord-américains dans un hôtel de San Francisco. Deux des principaux assistants de Kim appartenaient déjà à l’Église de l’unification. À cette occasion, Kim aurait promis, entre deux consommations, de travailler de façon clandestine pour l’Église tant en Corée du Sud qu’en Amérique.
Trois ans plus tard, alors qu’il dirigeait encore la KCIA, Kim fut promu président honoraire de la Korean Cultural Freedom Foundation (KCFF), le premier groupe « homme de paille » de l’Église aux États-Unis.
Selon le Comité Fraser, les relations amicales entre Moon et les autorités coréennes se sont poursuivies par la suite. Le gouvernement sud-coréen a encouragé des entreprises de Moon telles que la Radio Free Asia et Les petits anges. Il a même accordé à Bo Hi Pak les avantages de la valise diplomatique. En une occasion, la KCIA a engagé à Washington trois secrétaires sur la recommandation de la FLF de Moon.
Moon n’a aucun ennui quand il organise des ralliements en Corée du Sud. Il est même arrivé que le président de la Chambre à Séoul ait offert un banquet en l’honneur de Moon.
En échange de ces bons offices, les lobbyistes de Moon à Washington s’emploient à convaincre les élus américains à maintenir en Corée du Sud 40 000 soldats comme aide militaire et à fournir des milliards de dollars annuellement comme aide financière. De plus, les Moonies organisent de temps à autre, en Corée, des manifestations en faveur du régime Park. Le Rapport Fraser spécifie même que, l’une de ces manifestations mises sur pied aux États-Unis le fut à la demande expresse de la KCIA.
Moon va encore plus loin dans son appui à la Corée du Sud. Dans son ouvrage Le Principe divin, il enseigne que la Corée du Sud est la sainte patrie, un « second Israël » et que la langue coréenne, langage sacré s’il en fût, sera un jour universelle.
Il se fait on ne peut plus rassurant. Lors d’un grand ralliement en Corée du Sud, en 1975, il affirma que dans l’éventualité d’une autre guerre sur le sol coréen, les membres de l’Église de l’unification « croient que ce sera se conformer à la volonté de Dieu que de défendre la patrie de leur Père, de partir en croisade conjointement avec l’armée et de soutenir les vaillants défenseurs de la Corée et du monde libre ». (Les soulignés sont de l’auteur.)
Les ambitions de Moon dépassent les frontières de la Corée. Il veut en faire plus qu’une simple rampe de lancement en vue de « conquérir et de subjuguer le monde ». Dans son livre Le Maître parle, il répète à satiété qu’il contrôlera un jour toutes les institutions et établira une « théocratie mondiale » dont il sera le chef incontesté.
Il prévoit même une guerre sans merci au cours de laquelle « nous devrons, dit-il, vaincre Kim Il-Soung (président de la Corée du Nord), écraser Mao Tsé-Toung et terrasser l’Union soviétique, et tout cela au nom de Dieu ».
Ajoutons que Moon peut défendre les intérêts à court terme de la Corée du Sud, il peut même être un agent au service du gouvernement sud-coréen et de la KCIA, mais ses ambitions sont plus vastes encore.
« Ma vie, dit-il, est trop précieuse pour le monde entier pour que je me contente d’être un simple agent de la KCIA. Plus que la Corée, je veux l’Amérique. L’univers m’appartiendra un jour. »
JAPON
Le Comité Fraser n’a pas touché, même de loin, à l’un des aspects les plus importants de l’empire politique de Moon: sa liaison avec certaines puissances japonaises, liaison qui serait encore plus forte que ses liens avec la Corée. La branche japonaise de l’Église, le Genri Undo, dont l’influence est énorme, est liée aux très solides mouvements d’extrême droite en Asie. Les trois principaux supporters orientaux de Moon sont Ryoichi Sasagawa, Nobusuke Kishi et Yoshio Kodama — milliardaires d’après-guerre et forces politiques qui rêvent de redonner au Japon et à son empereur leur ancienne gloire. Certains pensent que ces trois hommes sont les vrais patrons de Moon.
Créateur au Japon pendant la guerre des escadres de pilotes Kamikaze (suicide), Sasagawa est le parrain de la mafia japonaise. Emprisonné comme criminel de guerre en 1945, il fut bientôt relâché et devint milliardaire en Indonésie et au Cambodge. Il appuie activement l’Église de l’unification au Japon. Bo Hi Pak le qualifie « d’homme authentiquement humanitaire et patriote » tandis que Moon le dit « très près du Maître ».
Sasagawa fut aussi au centre de la Old China Lobby — une association de dictateurs asiatiques, de politiciens américains de droite et d’hommes d’affaires internationaux. Cette association eut son gros mot à dire quand vint le moment de planifier la politique des États-Unis dans le Pacifique après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1960, Sasagawa fonda la World Anti-Communist League (WACL), l’une des plus impressionnantes fédérations de forces de droite dans le monde. En tant que membre de la WACL, la branche japonaise de l’Église en a organisé le congrès annuel en 1970. Moon déclara avoir recueilli 1,4 million de dollars par la vente des fleurs pour ce congrès de la WACL, « le plus réussi de tous ».
Le préposé à la publicité de cette réunion fut Nobusuke Kishi, un autre supporter de l’Église au Japon. Kishi fut premier ministre à Tokyo et il demeure le président du parti au pouvoir.
Le troisième membre de ce triumvirat de droite, Yoshio Kodama est « l’un des hommes les plus influents en Orient », selon le New York Times. Récemment, son nom apparut dans les journaux à l’occasion du scandale des pots-de-vin Lockheed, scandale où le gouvernement japonais se trouve lui-même compromis.
Kodama passe pour être la cheville ouvrière de la politique japonaise. Il a joué un rôle de premier plan dans la nomination de plusieurs chefs du gouvernement de Tokyo. Sans être promoteur actif de l’Église, il n’en a pas moins agi comme aviseur de Kishi lors du congrès de la WACL en 1970. Les liens entre Moon d’une part et, d’autre part, Kodama, Kishi et Sasagawa ont fait penser que la source des premiers financements destinés aux œuvres de Moon aux U.S.A. se trouvait au Japon. Le magazine Harpers est même allé jusqu’à insinuer que cet argent provenait des pots-de-vin Lockheed. Si c’était vrai, Moon aurait été financé d’abord par des fonds américains!
Moon entretient aussi des liens d’amitié avec Takeo Fukuda. Encore premier ministre en 1974, Fukuda assista à un banquet en l’honneur de Moon, accompagné de deux membres de son cabinet. Interrogé à ce sujet à la Diète japonaise, Fukuda répliqua: « Moon est un homme de grande valeur. Sur bien des points, sa philosophie coïncide avec la mienne. Nous avons à peu près les mêmes idées sur la nécessité de la coopération et de l’unité… Il a créé sur moi une très forte impression. »
Moon a également beaucoup d’amitié pour Shintaro Ishihara, directeur au Japon de l’environnement. Aux élections de 1976, des Moonies firent du porte à porte en faveur de Ishihara. Peu après avoir été élu, participant à un dîner de l’Église, le politicien nippon dit sa gratitude: « Vos gens m’ont beaucoup aidé. Je fus heureux de rencontrer tant de chics jeunes gens au Japon. »
D’après de sérieux analystes, Moon serait beaucoup plus qu’une marionnette au service du gouvernement sud-coréen. D’après Andrew Ross, éminent journaliste qui étudie les théories de Moon depuis des années, « Moon serait au centre d’une constellation des forces de droite… Énorme, sa puissance aurait de quoi nous terrifier. »
Quelle est la situation aujourd’hui?
Depuis le Rapport Fraser, le gouvernement sud-coréen s’est employé à se dissocier de Moon et de son Église. Il a annulé les passeports des Petits Anges et poursuivi, pour une fraude fiscale de 6 millions de dollars, le président de la compagnie de thé ginseng. (Ce président s’est enfui au Japon.)
Toutefois, le Comité Fraser pense que le gouvernement sud-coréen a continué discrètement son appui à Moon, au moins jusqu’en 1978. Cette année-là, les usines de Moon se virent octroyer de nombreux contrats à titre de principaux fournisseurs d’armements pour le gouvernement coréen.
Vers la fin de 1977, survint un incident curieux. La compagnie américaine Colt avait proposé un contrat pour une vente d’armes au gouvernement sud-coréen. Plusieurs semaines plus tard, Colt recevait un appel d’un représentant de l’usine Tong-Il, propriété de Moon, disant qu’il acceptait, au nom de la Corée du Sud, le contrat proposé. À son dire, Séoul avait donné son plein accord. Cependant, ajouta-t-il, « si l’affaire transpire et devient publique, nous nierons tout et nous vous accuserons de calomnie ».
On peut lire dans le rapport du sous-comité: « Dans les circonstances, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des États-Unis de savoir quel contrôle Moon et ses adeptes exercent sur les armements et jusqu’où s’étend leur influence en ce qui regarde la politique de défense de la Corée. »
L’assassinat du président Park vers la fin de 1979 a remis en question la position de Moon en Corée du Sud. Quelle sera l’attitude de nouveau gouvernement, celui de Choi Kyu-Hah? Nul ne le sait. Néanmoins, on peut noter la présence parmi les ministres du très influent Kim Chong-Pil, l’homme qui rencontra secrètement, en 1961, les chefs de l’Église de l’unification à San Francisco et qui fut nommé plus tard président honoraire de la KCFF.
En Amérique, on note ici et là des indices prouvant que le mouvement de Moon est loin d’être mort. Ses investissements continuent de croître dans les pêcheries, le cinéma, les publications et l’immeuble. Son congrès scientifique annuel attire encore des savants du monde entier. Celui d’octobre 1980, qui a eu lieu à Miami, fut un grand succès.
Après un séjour de plusieurs mois à l’étranger, le temps qu’expire un subpoena émis par le Comité Fraser, Moon est revenu aux États-Unis. Il parle d’un mariage collectif de dix mille couples pour 1981. Les préparatifs sont déjà en marche: en mai et en décembre 1980, il a célébré les fiançailles de 1 500 couples. Plusieurs des fiancés ne se sont jamais rencontrés. Moon voit lui-même au choix.
Peut-être l’exemple le plus éloquent de la puissance persistante de Moon aux États-Unis se trouve-t-il dans la victoire qu’il a remportée contre son ennemi numéro un, le républicain Donald Fraser.
Aux élections primaires de 1978, les Moonies menèrent une active campagne contre Fraser dans son État natal du Minnesota. Comme le note Fraser dans son rapport, tous les organismes à la solde de Moon furent mobilisés contre lui. Des brochures anti-Fraser furent imprimées par une compagnie de Moon et ses cinéastes tournèrent des documentaires pas toujours élogieux, pour diffusion en Corée. Des articles qui bafouaient Fraser et transformaient Bo Hi Pak en martyr furent insérés dans le journal News World. Des membres de l’Église parlèrent contre Fraser dans les rues.
Les résultats furent ceux que l’on avait escomptés. Le 7 octobre, à peu près un mois avant que le Comité ne présente son rapport final, Donald Fraser était battu comme candidat républicain au Sénat.
Donald Fraser s’était écroulé sous les coups assenés par le très puissant Sun Myung Moon!
Il s’était mesuré à un adversaire de taille, plus fort que lui.
Chapitre VII
Il nous fallut deux longues journées à San Francisco pour compléter notre Commando de l’enlèvement. L’équipe comptait sept individus: quatre médecins d’âge moyen, l’« homme des montagnes » de la Caroline, un administrateur dans le textile et un détective privé d’origine italienne. Ces gens n’avaient rien des kidnappeurs professionnels mais, pressés par le temps, nous ne pouvions nous permettre de faire les difficiles. Pour être enrôlées, il suffisait à nos recrues d’avoir de la bonne volonté. Aucune compétence spéciale n’était requise.
Le premier à se joindre à nous fut Keith, l’homme des montagnes, avec qui je m’étais enfui de Boonville. Je l’avais retracé à San Francisco, le cher homme, le jovial citoyen de la ville imaginaire « La Gloire des Fainéants ». De tout cœur, il avait accepté mon invitation.
Le second à se laisser conscrire fut un ami de toujours, le Dr M., anciennement de Montréal. Médecin genre hippie, il avait fui le Canada pour la Californie afin d’y trouver les trois éléments de son paradis: de la chaleur, des femmes, des drogues.
J’appelai ensuite le Dr David Leof, psychiatre, que j’avais consulté après mon départ de Boonville. Mon récit l’avait tellement horrifié qu’il m’avait promis une aide inconditionnelle. Il allait tenir parole. Pour nous donner un coup de main, il annula tout un après-midi de rendez-vous et sacrifia momentanément son pacifisme de toujours. Il m’amena même deux de ses amis, le Docteur G. et le Docteur F., spécialistes en maladies des reins, non en enlèvements.
Pour compléter notre équipe, il nous fallait un détective privé. Nous en avions surtout besoin pour nous renseigner sur les déplacements de Benji, de sa mère et de sa sœur à l’aéroport.
« Vous êtes branché sur le répondeur automatique de Mick Mazzoni. Parlez aussi longtemps que vous le voulez, mais tenez-vous-en aux faits », voilà le message préenregistré que nous transmit la voix du détective privé que nous souhaitions embaucher.
Après avoir rejeté dans leur nullité une bonne douzaine d’exploiteurs, nous avons enfin trouvé notre homme: Mazzoni. Il s’était décrit lui-même au téléphone comme « l’homme aux mille déguisements ». Alors que nous l’attendions sur le trottoir devant le hall de notre hôtel, nous n’aurions pas été surpris de le voir arriver, ce détective caméléon, sous l’apparence d’une vieille dame inoffensive. Aussi bien, fûmes-nous un peu déçus quand il se présenta, car il n’avait rien de très original. Ancien policier avec les tics d’un adjudant, Mazzoni avait des traits rugueux et une barbe. Était-elle vraie ou fausse? Je ne l’ai jamais su. Ses vêtements? On aurait dit qu’il ne les avait pas enlevés pour dormir depuis une semaine. Ses yeux, ultra-mobiles, fouillaient tous les coins de notre chambre comme pour y découvrir des explosifs.
— Un bon enlèvement ressemble à une bonne réparation de pneu crevé, nous dit-il, après avoir écouté l’exposé de notre stratégie. Un enlèvement, il vaut mieux ne pas le faire du tout plutôt que de le faire mal.
Mazzoni nous donna un lot de bons conseils. Il nous suggéra, par exemple, de changer pour une Cordoba deux portes la voiture que nous avions d’abord choisie pour la fuite.
— Dans la Cordoba, dit-il, il y a amplement de place pour tasser un corps entre le siège avant et le siège arrière. De plus, les ceintures de sécurité n’embarrassent pas. C’est la voiture idéale pour les enlèvements.
Il insista pour que nous placions une voiture de secours à quelques milles de notre point de départ, près du parc Candlestick, au cas où notre première voiture serait repérée. Il nous indiqua même la meilleure manière de placer les deux voitures (tête à queue) pour un transfert rapide de Benji de l’une à l’autre.
Avant de partir, il tint à nous enseigner quelques notions élémentaires de judo. Notre chambre se transforma en un petit gymnase où les corps volaient dans les airs pour aller s’écraser sur les murs ici et là. La leçon fut brève car les voisins ne tardèrent pas à venir se plaindre de nos bruyantes prouesses.
Avant de passer la porte, Mazzoni me glissa dans la main un tube de gaz lacrymogène.
— Si les choses se gâtent, murmura-t-il, employez ce machin-là. Rien n’est plus utile pour se sortir du pétrin quand on est encerclé.
La location d’une Cordoba se révéla plus compliquée que prévue. Surtout qu’entre les visites aux agences il nous fallait revenir à l’hôtel pour prendre les messages arrivés en notre absence.
Contrairement à nous quatre, Lenny, Gary, Simon et moi-même qui résistions à la fatigue, le père de Benji sommeillait sur la banquette arrière de la voiture. Il paraissait désorienté. Faible de santé, il se réfugiait souvent dans le sommeil. Entre deux sommes, il faisait de son mieux. Sa vaste expérience lui permettait de nous donner de bons conseils. Ses histoires comiques nous détendaient. Bien vite cependant, il retombait dans les bras de Morphée pendant que nous, nous continuions à nous débattre.
La première fois qu’il paya Mazzoni, il fondit en larmes, effondré par le caractère quelque peu macabre des services qu’il achetait. Mais ce ne fut que passager et il s’adapta remarquablement bien à la situation. Il ne refusait jamais de se joindre au groupe, quelle que soit l’heure tardive, pour déguster une pizza ou ingurgiter un bon scotch.
Les embêtements ne manquaient pas. Ainsi en fut-il au moment de louer la seconde voiture. Ce fut tragico-comique. Lorsque cette voiture de rechange sortit du garage, Simon se mordit les lèvres et murmura à Lenny:
— Catastrophe!… Qu’allons-nous faire?… C’est une autre Cordoba bleue!…
Simon ne nous voyait pas sautant d’une Cordoba bleue à une autre semblable pour dépister des poursuivants. Il s’adressa donc à la demoiselle au comptoir:
— Vous n’allez pas me croire et pourtant c’est vrai. Je ne puis pas supporter le bleu. Je suis allergique au bleu.
— Moi aussi, ajouta Lenny, le bleu me rend malade.
Stupéfiée, la jeune fille les regarda comme s’ils eussent été des Martiens.
— Écoutez, dit-elle, soyez raisonnables. D’autant que c’est seulement pour une journée.
— Je voudrais bien être raisonnable, Mademoiselle, reprit Simon. Mais c’est plus fort que moi. Le bleu me donne des nausées.
Quelques hommes d’affaires attendaient leur tour au comptoir. Ils avaient tout entendu. À l’unisson, ils reprirent sur un ton de lamentation:
— Pauvre lui! Le bleu lui donne des nausées!!!
La jeune fille téléphona au gérant du garage,
lui demandant une Cordoba de n’importe quelle couleur, sauf bleue. Apparut une voiture verte.
— Oh! s’extasièrent Lenny et Simon. Le vert, c’est notre couleur préférée. Nous sommes ravis.
Il ne fut pas facile, non plus, de trouver l’hôtel qu’il nous fallait. Nous voulions un emplacement un peu isolé, avec un unique portail que deux voitures pourraient facilement obstruer tout de suite après notre départ avec le kidnappé. Nos recherches nous amenèrent des palaces les plus chics aux bouges les plus infects.
Dans l’un des motels, Gary réussit à s’emparer du passe-partout accroché au mur, derrière le bureau de réception. Furtivement, sur la pointe des pieds, on inspecta les chambres l’une après l’autre, jusqu’au moment où, ouvrant une porte, on surprit deux « pigeons » en flagrant délit d’amour… À un autre endroit, nous allions louer une chambre à l’étage quand M. Miller nous dit sa peur de voir Benji chercher à s’évader par la fenêtre. Encore une fois, il fallut changer nos plans.
Mazzoni nous avait conseillé d’acheter une grosse chaîne et un cadenas. En reliant, par la chaîne, le volant de la voiture des Moonies à un poteau, on empêcherait nos adversaires de se lancer à notre poursuite. C’était là une méthode moins brutale que de lacérer les pneus ou de fracasser le pare-brise à coup de masse. Tout de même, quand on essayait de voir, sur le terrain, comment se déroulerait l’opération, notre grosse chaîne éveillait les soupçons des gens. Comment aurait-il pu en être autrement?
Après 16 heures de recherches et la visite de douzaines d’hôtels, nous avons jeté notre dévolu sur une petite auberge, bon marché mais charmante, un peu à l’écart d’une autoroute. Après la location de deux chambres, notre groupe s’installa sur la terrasse pour se familiariser avec les allées et venues en cet endroit.
Il était 17 heures. Bientôt de jeunes et jolies blondes arrivèrent en voitures sport et montèrent aux chambres de l’étage. Quelques minutes plus tard des hommes, venus en somptueuses Cadillac ou Continental, montèrent à leur tour. Pour compléter l’inquiétant tableau, des voitures de police entraient et sortaient du terrain de stationnement presque sans arrêt.
Alarmé, Charlie Miller murmura:
— Bondance de la vie!… Mais nous sommes dans un bordel.
Pendant que nous nous préparions à fuir, nous avons fait une découverte plus fantastique encore. Partout dans l’hôtel, des caméras cachées auraient enregistré tous nos faits et gestes… Nos effets personnels et la chaîne replacés dans la voiture, nous avons déguerpi à la hâte sans tambour ni trompette.
Deux heures plus tard, nous choisissions le Holiday Inn de l’aéroport. C’était un peu luxueux et il y avait plusieurs portails. Mais nous n’avions plus le temps de chercher mieux. Nous avons donc loué deux chambres communicantes. L’une pour Mme Miller et sa fille; elles y recevraient Benji. L’autre nous servirait de cachette.
Enfin! le piège était armé! Il était temps. Cette étrange odyssée durait déjà depuis quatre semaines.
Keith, l’homme des Montagnes sur les muscles duquel nous comptions, accusa un retard considérable sur l’horaire prévu. Pourtant il était parti tôt du chantier où il travaillait. Il avait même promis un pourboire de 10$ au chauffeur de son taxi. Mais un pneu creva et la voiture fit une embardée. Keith continua sa route, tantôt à pied tantôt en auto-stop. Mais son retard était trop considérable. À son arrivée à l’hôtel, il ne restait plus personne, sauf des policiers à la recherche de criminels ravisseurs.
Dès le début, toute l’affaire se révéla un beau gâchis. Un quart d’heure avant le moment H de l’enlèvement, personne n’était encore arrivé à l’hôtel, sauf nous et le Dr M.. Nous en étions consternés. À la toute dernière minute, le Dr Leof arriva dans sa majestueuse Mercedes, avec son épouse et leur garçon de cinq ans. Il avait amené avec lui le Dr G. et le Dr F., tous deux engoncés dans des complets chics, comme pour un congrès médical international.
On récapitula en vitesse les principaux points de la stratégie à employer. Puis chacun se rendit à son poste. On plaça nos quatre voitures de manière à forcer Benji et les Moonies à stationner juste devant notre chambre. À l’un des volants se tint le Dr G., sur le qui-vive pour couper le chemin aux Moonies qui voudraient éventuellement se lancer à notre poursuite. Dans l’une des autres voitures, Charlie Miller se tenait prêt à quitter les lieux avec sa femme et sa fille.
Le Dr Leof et sa famille déchargèrent leurs bagages à la manière de touristes en vacances. Mme Leof mobilisa même son fils pour l’opération. En lui remettant une valve de pneu, elle lui dit:
— Prends ceci, Anton. Si les méchants essaient de se sauver, tu dégonfleras leurs pneus — phffft!
Un peu plus loin, le Dr M. attendait nerveusement dans la voiture de l’évasion. Comme il pianotait sur le tableau de bord, un énorme camion du Holiday Inn vint se placer juste devant lui. Le Dr Leof alla au secours de son confrère et dit au chauffeur:
— Je suis un psychiatre chargé de ramener à l’asile un fou dangereux qui s’en est évadé. Voici ma carte d’identité. Le FBI est sur les lieux pour m’aider. Veuillez aller stationner ailleurs.
Pendant ce temps-là le Dr F. et nous quatre étions confinés dans une chambre contiguë à celle qu’allaient occuper Benji, sa mère et sa sœur. À travers les rideaux tirés, par un minuscule trou, à tour de rôle, nous essayions de voir ce qui se passait. Pour le moment, dans notre champ de vision, il n’y avait qu’une grosse dame en train de pratiquer son golf sur un terrain voisin. Il était 17h45. Selon l’horaire, l’avion avait dû atterrir à 17h30. Encore aucune nouvelle de Mazzoni et de ce qui se passait à l’aéroport. L’attente devenait insupportable.
Enfin le téléphone sonna. C’était Mazzoni.
— Benji est ici avec un autre Moonie, dit-il. Ils ont accueilli tantôt Mme Miller et Debbie… Ils se dirigent vers leur voiture… Ils y montent… Ils partent… C’est une Mustang 1976… Tenez-vous prêts!… Bonne chance!…
Plusieurs longues minutes s’écoulèrent. Des minutes de dentistes. Les nerfs à fleur de peau, nous sursautions au moindre bruit.
Enfin Simon rompit le lourd silence:
— Je la vois… Oui, c’est une Mustang argentée… Elle vient juste ici.
Je pris la relève. J’écarquillai un œil pour mieux voir à travers le trou. Que je regrettais ne pas l’avoir agrandi, ce trou! J’ai vu la voiture déjà stationnée. Des portières ouvertes obstruaient partiellement ma vision. Je vis d’abord des jambes puis quelques malles… puis deux paires de jambes dont l’une de femme. Impossible de voir plus haut que la taille des arrivants.
La porte de la chambre voisine se referma. Benji était-il resté dans la voiture? Était-il entré? Fallait-il attendre? L’autre Moonie était-il grand et fort?
La Mustang recula et s’en alla au stationnement. Mais je ne pouvais pas voir qui était le chauffeur.
En collant nos oreilles au mur mitoyen, nous avons essayé d’identifier la voix des occupants de la chambre voisine. Je prétendais reconnaître celle de Benji. Mes compagnons avaient une opinion contraire. Que faire?
Dans un geste de bravoure désespéré, le Dr Leof chercha à nous sortir de l’impasse. Il vint vers nous en courant et, frappant à tour de bras à la porte de notre chambre, il hurla si fort que tout l’hôtel put l’entendre:
— Que diable faites-vous là-dedans? Benji se trouve dans la chambre voisine. Sortez au plus vite et ENLEVEZ-LE!
Sans plus attendre, Simon et moi-même sommes sortis par la porte d’en avant tandis que Lenny et Gary enfonçaient la porte de communication. Sans doute encore occupé à stationner sa voiture, le Moonie n’était pas là. Benji et sa mère se trouvaient dans la salle de bains, en train de disposer des fleurs dans un pot. En voulant s’emparer de Benji, Gary fit un faux mouvement et, sans le vouloir évidemment, bouscula Mme Miller qui tomba dans la baignoire. Elle avait l’air d’un cadavre couvert de fleurs dans sa tombe.
Lenny, Simon, le Dr Leof et moi-même sommes arrivés à la rescousse. Benji nous regarda avec des yeux horribles, terriblement vides de toute expression. Mais, la seconde d’après, apercevant son copain Simon, il redevint pour un instant le bon vieux Benji d’autrefois.
— Bonjour, Simon!… Qu’est-ce que tu fais ici?
Mais aussitôt ses yeux reprirent leur air perdu.
Et le pauvre homme chercha à s’échapper comme si nous étions tous, même ses parents, des étrangers et des ennemis. Pendant que mes compagnons l’immobilisaient, je sortis à la course.
Stupéfait, j’aperçus le Moonie en train de se préparer à partir pour alerter la police. Chargé de bloquer pareille manœuvre, le Dr G. n’en avait rien fait. Il s’était endormi.
Je courus vers la voiture du Moonie. Incapable d’ouvrir la portière, je me jetai à plat ventre sur le capot. À travers le pare-brise, fixant le Moonie je lui criai:
— Non!… Non!… Non!…
Je réussis à ce moment à ouvrir la portière et je bluffai effrontément:
— Attendez! Attendez! Nous voulons seulement parler à Benji. Écoutez-moi! Nous avons en main des ordes de déportation, mais nous ne voulons pas nous en servir. Il nous suffira de causer avec notre ami…
Je ne savais plus qu’inventer lorsque je vis le Dr G. arriver sur nous en trombe et arrêter sa voiture à quelques centimètres de la Mustang, lui bloquant hermétiquement le chemin. Le Dr G. sortit et vint à nous.
— FBI! cria-t-il tout en exhibant une pièce d’identité quelconque.
Et il agrippa le Moonie par le col de sa chemise en glapissant:
— Dehors! Espèce de voyou!
J’intervins:
— Arrêtez-vous! dis-je au Dr G. … Nous avions une entente… Vous nous avez promis de ne pas vous immiscer dans l’affaire si on nous permettait de parler à Benji… Ne manquez pas à votre parole…
Le Moonie ne savait plus qui croire ni que penser. Il nous regardait l’un après l’autre avec des yeux égarés. Nerveux, tremblant, il finit par demander:
— Qu’est-ce qui se passe?… Que voulez-vous?…
Surpris par la présence de son père et de plusieurs amis dans l’équipe d’enlèvement, Benji n’en continuait pas moins de lutter pour s’échapper de la chambre. Lenny finit par venir me chercher dans l’espérance que la présence d’un autre copain parviendrait à briser la résistance de notre pauvre ami. Je laissai le Dr G. et le Moonie se débrouiller entre eux et je courus à la chambre pour raisonner Benji. Je ne pus le faire. Quand je vis ses yeux atrocement vides et sans âme, j’éclatai en sanglots.
— Espèce de faux-frère, dis-je entre mes larmes… Nous avons dépensé dix mille dollars et six semaines de notre temps pour venir ici, juste pour te parler… Et tu nous reçois comme ça… Sans-cœur!…
Sans doute ému par mes larmes et celles de ses parents, Benji relâcha un moment sa défensive. Simon et Lenny en profitèrent pour lui coller les bras au dos et le pousser dehors. Pendant que nos deux camarades traînaient Benji vers la voiture, il nous sembla que tous les hôtes et tous les employés du motel regardaient le spectacle. Le Dr Leof leur cria:
— Ne vous inquiétez pas!… Je suis un psychiatre… Je viens chercher un patient évadé de l’asile.
Le Moonie avait profité de la confusion générale pour se dégager et s’en aller demander du secours à la police. Quand au Dr M., il approcha de nous la voiture prévue pour la fuite, les portes s’ouvrirent. Je me laissai tomber sur le siège arrière, entraînant Benji avec moi. Simon se jeta sur nous deux. Il y avait un enchevêtrement de jambes qui empêchait de fermer la portière. Gary poussa le tout à l’intérieur comme si ça avait été des bâtons en bois. Puis il sauta sur le siège avant, à côté du chauffeur. Les pneus grincèrent. La voiture fit un soubresaut, sortit du stationnement, accéléra rapidement et, dans le temps de le dire, gagna l’autoroute.
— Enfin! Enfin! soupirai-je.
Et je desserrai mon étreinte. Elle n’était d’ailleurs plus nécessaire. Benji se tenait assis, droit comme une barre de fer, les yeux rivés au plancher, dans un état de catalepsie qu’il devait garder plus de 24 heures. Rien de ce que nous allions dire ou faire n’allait pouvoir le faire sortir de cette sorte de transe hypnotique. Pour le moment, nous filions sur l’autoroute dans un silence complet, nous demandant quelle devrait être notre prochaine initiative.
Quarante-cinq minutes plus tard, nous stationnions la voiture dans le garage souterrain de notre hôtel de Berkeley. De larges sourires triomphants s’étalaient sur nos figures en sueur. Benji sortit du véhicule, toujours aussi figé et impassible.
Soudain, il s’arrêta et s’agenouilla pour renouer un lacet de soulier. À peine relevé, il s’élança vers la sortie, mais nous l’avons facilement rattraper. À contrecœur, il fallut de nouveau lui coller les bras au dos. Et c’est ainsi que nous avons monté les trois étages d’un escalier situé dans la partie arrière de l’hôtel. À peine avions-nous installé notre ami dans notre chambre — et poussé un gros soupir de soulagement — que nous nous sommes employés à barricader la porte en y entassant tables et chaises.
De mauvaises nouvelles nous y attendaient. Les Miller étaient déjà revenus à leur chambre du rez-de-chaussée. Mais Mme Miller, victime sans doute de sa haute tension et de trop fortes émotions, se sentait très mal. Un médecin avait été appelé d’urgence. M. Miller ajouta au téléphone:
— Je le regrette, mais votre chambre — oui! la chambre où vous êtes — est enregistrée à mon nom. De ce fait, elle est facilement repérable. C’est un gros problème. Il faudrait peut-être vous en occuper au plus vite.
Je descendis à la course. Parvenu au hall d’entrée, je ralentis et je me dirigeai vers la réceptionniste, une matronne grassouillette d’un âge moyen. Visiblement, je ne l’impressionnais guère avec mes cheveux ébouriffés et mes vêtements chiffonnés.
— Euh!… Euh!… dis-je d’une voix où se trahissait l’essoufflement… Serait-il possible de changer immédiatement l’enregistrement de notre chambre?
— Et pourquoi? demanda-t-elle sans même un soupçon de bienveillance.
J’étais coincé.
— Madame, lui dis-je, avez-vous déjà entendu parler du « Révérend » Moon?
— Le bâtard! dit-elle en son langage cru. Quelqu’un devrait lui loger une balle entre les omoplates.
— Oh!.. Oh!… soupirai-je.
Prestement, je lui racontai notre odyssée et sollicitai son aide. Un sympathique sourire aux lèvres, elle acquiesça sur-le-champ. Puis elle ajouta, maternelle:
— Voulez-vous un conseil? Votre groupe, là… changez votre comportement. Avec vos chuchotages, vos regards soupçonneux, vos allées et venues nocturnes, vous sentez le complot à plein nez. Changez. Autrement, des gens zélés vont vous dénoncer à la police. Reprenez au plus vite l’allure de personnes normales.
Je revins à la chambre. Je trouvai, entre autres, M. Miller qui essayait de capter l’attention de son fils. En vain. Même les plus touchantes paroles ne l’atteignaient pas. Quand le pauvre père, habituellement jovial, abandonna la partie et retourna vers son épouse indisposée, de grosses larmes coulaient sur ses joues.
Debbie, la sœur de Benji, n’eut pas plus de succès. En larmes elle aussi, elle demanda à son frère:
— Benji, qu’as-tu? Qu’est-ce qui ne va pas?
Le frère et la sœur ne s’étaient pas vus depuis un an, mais Benji feignait de ne pas la reconnaître.
Le mur de silence demeurait désespérément infranchissable.
Pendant quelques instants, nos sourires revinrent. Ce fut quand Mazzoni nous téléphona pour nous dire:
— Félicitations. Je suis fier de vous autres. Pour un premier enlèvement, c’est vraiment réussi. Vous êtes des gars appelés à un brillant avenir.
Après M. Miller et Debbie, j’essayai à mon tour de parvenir jusqu’au vrai Benji. Je lui lus le dossier sur les immenses richesses de Moon, richesses acquises grâce au travail de pitoyables esclaves.
Nous nous préparions à continuer, toute la nuit, et tenter de ramener Benji à lui-même, quand, soudain, le téléphone sonna. Gary répondit. C’était la réceptionniste.
— Descendez au plus vite, dit-elle. J’ai besoin de vous voir. C’est urgent.
Gary descendit quatre à quatre. Tout énervée, la brave dame lui dit:
— La police vient d’appeler. Ils veulent savoir s’il y a ici un M. Miller. J’ai dit que je ne donnais pas ce genre de renseignements par téléphone. Ils m’ont alors annoncé leur visite.
— Ouais! soupira Gary. Ont-ils dit quand ils arriv ……
Gary n’eut pas le temps de finir. Pâle, d’une pâleur de cadavre, la dame lui siffla entre les dents:
— Ils sont là, juste derrière vous, à dix pas…
Chapitre VIII
Nous nous étions réfugiés dans un petit cottage dans lequel une chambre à coucher bleue servait de cellule à Benji. Nous y étions à l’étroit mais beaucoup moins que dans une cellule de la police à laquelle nous venions d’échapper de justesse.
Quinze minutes plus tôt, tout au plus, nous étions assis confortablement dans notre chambre de l’hôtel Berkeley lorsque Gary s’y était précipité et nous avait annoncé, tout essoufflé, que la police et les Moonies étaient en train de fouiller l’édifice. Les agents avaient passé à deux pas de lui sans le soupçonner. Il s’était glissé entre deux officiers comme un parfait gentilhomme en murmurant: « Excusez-moi! » Puis il avait traversé le hall d’entrée d’un pas tranquille en se faufilant entre les policiers et les Moonies envahisseurs. Ensuite, hors de vue, il s’était mis à courir et avait monté les escaliers en vitesse.
Quelques secondes plus tard, après avoir saisi Benji, nous l’avons descendu, comme un sac de patates, par l’escalier de service. Ce fut ensuite l’entassement rapide dans l’auto et la sortie en éclair du garage. À ce qu’on nous a dit plus tard, à peine avions-nous atteint la rue que la police commençait à fouiller notre chambre.
Par une heureuse coïncidence, le Dr M., l’ancien médecin hippie de Montréal, demeurait à proximité de l’hôtel. En quelques minutes, nous étions arrivés à son cottage dont il occupait deux pièces, une toute petite chambre et une vaste salle de séjour. La minuscule chambrette servirait de cellule où nous garderions notre prisonnier. Nous vivrions, nous, entassés les uns sur les autres, dans la seconde pièce. Celle-ci était meublée à la diable: des fauteuils crevés, un appareil stéréo de prix, un hamac, un stéthoscope qui n’en était plus à sa première jeunesse, et d’autres objets sans valeur. Sur la porte d’entrée on pouvait lire: « Pour être certain d’atteindre la cible, tirez d’abord et quel que soit l’objet atteint… appelez-le la cible. »
Dès l’arrivée, on barricada les fenêtres et l’on enleva de la chambre de Benji tous les objets pointus ou coupants, tels que crayons et bouteilles. D’après nos renseignements, plusieurs Moonies recevaient comme consigne de mourir plutôt que de se laisser déconditionner. On leur donnait même parfois des lames de rasoir avec des instructions sur la manière de s’en servir. « Angle incliné pour aller à l’hôpital. Angle droit pour mourir. » Avait-on enseigné cette technique à Benji? Nous l’ignorions. Mais étant donné son état lamentable, nous ne devions prendre aucun risque.
Benji était pâle et maigre à faire peur. Autrefois tellement jovial et ricaneur, il avait maintenant des yeux fixes, avec des pupilles deux fois leur grosseur normale. Toujours en état de catalepsie, il fredonnait à voix très basse un refrain, toujours le même, dont nous avons su plus tard les paroles: « Gloire au Ciel! Paix sur la terre! Servez-vous de moi pour le salut du monde! »
À tour de rôle chacun lui criait de toute la force de ses poumons:
— Benji! Pourquoi agir de la sorte? Pourquoi refuser de nous parler? Nous voulons seulement discuter avec toi. Benji! réveille-toi! Pourquoi te taire ainsi? Benji! c’est insensé, nous ne voulons que parler avec toi.
C’était comme parler à un cadavre. Pendant des heures et des heures, notre pauvre ami resta assis, immobile et rigide comme une pierre, le dos cambré, les yeux vides, comme si nous n’étions pas là à l’interpeller sans cesse. C’était à n’y rien comprendre. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, nous étions tous certains d’avoir pris la bonne initiative. Cet enlèvement était nécessaire. Nécessaire également, nous en prenions de plus en plus conscience, l’intervention d’un professionnel en déconditionnement.
Tout le reste de la soirée, nous nous sommes relayés pour parler sans interruption à notre malade. Toujours aucune réaction. Vers vingt-trois heures, il s’étendit sur le lit et s’endormit presque aussitôt. Nous l’avons recouvert d’une chaude couverture avant d’éteindre la lumière.
Nous avons ensuite appelé nos amis de Montréal pour les mettre au courant des événements. Suivirent des appels à Neil Maxwell et à quelques autres sympathisants de San Francisco. Après des semaines d’hésitation nous avions décidé de leur demander de nous trouver un déconditionneur.
Puis quelqu’un ouvrit la télévision. Par le plus étonnant des hasards, ce fut la face de Sun Myung Moon qui apparut sur l’écran. Moon avait acheté une demi-heure à la télé pour parler à l’Amérique. Pendant de longues minutes, sa voix stridente et ses gestes tranchants d’as en karaté s’installèrent sur notre petit écran. Au programme, il y avait aussi le film d’un feu d’artifice, réalisé à Washington et commandité par les Moonies, qui l’avaient payé un million de dollars. Le tout se terminait par un vibrant appel de Moon à Dieu pour qu’il bénisse l’Amérique dans la guerre sainte contre le Démon communiste. « MAN-SEIÜ » crièrent 1500 Moonies en s’agenouillant devant Moon, les poings levés vers le ciel. « VICTOIRE POUR LE PÈRE. »
Nous avons passé la nuit en veillée de garde. Sentinelles pas mal ensommeillées, nous alternions aux trois postes dangereux: la chambre de Benji, les fenêtres avant et arrière de la maison. Geste plutôt symbolique car nous n’aurions pas pu nous défendre contre les policiers ni les Moonies s’ils étaient survenus. Les ténèbres enveloppant la cité transformaient les bruits les plus ordinaires en vacarmes suspects. Le bruissement des feuilles et le léger claquement des fenêtres sous le vent nous faisaient parfois sursauter. Les aboiements des chiens du voisinage nous semblaient venir de chiens policiers. Même la sirène d’une ambulance nous apparaissait comme le signe qu’une vaste opération de police était en cours et que nous allions tomber dans ses filets d’un moment à l’autre.
Un seul bruit faisait exception. Il nous amusait, celui-là, au lieu de nous effrayer. C’était le ronflement assourdissant de Benji. Nous le trouvions charmant comme une cantilène féerique parce qu’il nous rappelait le sympathique ami d’autrefois. C’était la seule caractéristique qui n’avait pas changé chez lui.
La nuit porte à la réflexion. Nous en avons profité pour nous poser des questions et chercher des réponses.
Depuis le début de notre aventure, nous avions plutôt agi par instinct, sous l’inspiration du moment. Maintenant que le kidnapping était réussi, de nombreux points d’interrogation surgissaient. Avions-nous agi sagement? Fallait-il recourir au service d’un déconditionneur? Comment se comporterait-il avec Benji, ce bon vieux copain qui s’obstinait à garder le silence avec nous?
Et que ferions-nous si nul conditionneur ne consentait à venir? S’il y en venait un et qu’il ne réussisse pas? L’unanimité se fit sur un point: dans l’éventualité où notre ami résisterait à toute tentative de déconditionnement, nous le laisserions partir au bout de quelques jours, quelles qu’en soient les conséquences!
Par ailleurs, qu’adviendrait-il si nous étions appréhendés? Comme nous étions plus de 40 à être impliqués dans l’enlèvement, serions-nous tous incriminés?
J’écrivis dans mon cahier de notes: « Sujet d’un article passionnant d’intérêt. » Le journaliste qui sommeillait en moi depuis plusieurs jours se réveillait donc. Bon signe!
Plusieurs heures plus tard, les premières lueurs de l’aurore se mirent à filtrer à travers les volets fermés. Nous étions tous, plus ou moins, abattus et hagards. Je décidai de risquer un appel à notre hôtel de Berkeley pour exposer notre situation à M. Miller et lui demander conseil. Nous n’avions pas de nouvelles de lui depuis notre départ précipité. Le téléphone sonna plusieurs fois. Quand Charlie finit par répondre, sa voix trahit une extrême nervosité.
— Josh, dit-il, Je ne puis pas parler. Il y a des policiers en faction dans notre corridor. On va peut-être nous amener en prison.
Pour Charlie Miller et les siens, les événements s’étaient précipités, allant très vite d’une simple contrariété à une horrible déception. Lors de l’enlèvement, Charlie avait vécu les instants les plus dramatiques de sa vie. Benji, méconnaissable, s’était montré d’une indifférence glaciale à l’égard de sa famille. Le chagrin de Mme Miller avait aggravé celui de son époux. Quand les gars avaient poussé Benji dans la voiture qui allait fuir, Charlie avait dû retenir dans ses bras la pauvre maman affolée.
Après ces violentes émotions, il restait à Charlie une pénible corvée: ramener à l’hôtel de Berkeley sa femme et sa fille. Le trajet lui avait paru bien long. En cours de route, Mme Miller lui raconta sa propre arrivée, à l’aéroport, quelques heures plus tôt:
— J’ai eu peine à reconnaître mon Benji. As-tu remarqué comme il a maigri? Et son regard? Ses yeux sont comme vides. Qu’est-ce qu’ils lui ont fait, à notre garçon?… As-tu remarqué le type qui l’accompagnait?… On dit que c’est notre neveu, le cousin de Benji.
Mais comme Charlie n’avait pas revu le cousin en question depuis trois ans, il ne l’avait pas reconnu. Un car de police s’amena en vitesse… Charlie tressaillit, mais la pâleur et l’inquiétude qu’il lisait sur les traits de sa femme lui causaient encore plus de souci. Il souhaitait arriver à l’hôtel au plus vite.
À l’hôtel, Charlie avait fait venir un médecin. Puis il était allé voir Benji amené par les gars à leur chambre. Ses efforts pour entrer en contact avec son fils s’étaient révélés infructueux. Même ses supplications les plus tendres n’avaient éveillé aucun écho.
Revenu à sa chambre, il avait entendu, un peu plus tard, un grand brouhaha dans le corridor.
Par peur de la police, il n’avait pas voulu regarder ce qui se passait. En fait, c’était Benji, traîné par les gars vers une nouvelle cachette.
Cinq minutes plus tard, des coups énergiques avaient été frappés à sa porte. Cette fois, c’était bien la police.
— M. Miller… Ici, le sergent-détective Sullivan… Ouvrez!
Grand et solide, avec un petit bedon, l’officier voulait voir Benji. Charlie répondit:
— Où est-il?… Je n’en ai pas la moindre idée.
— Excusez-moi d’insister, M. Miller. Moi aussi, j’ai une femme et des enfants. Mon métier m’oblige parfois à des démarches désagréables comme celle-ci. Mais le devoir, c’est le devoir. Dites-moi, votre garçon, où est-il?
— Franchement, je n’en sais rien.
Le sergent Sullivan aperçut alors la chemise où Charlie avait réuni sa documentation sur les Moonies. Sur la couverture s’étalaient trois majuscules: « BBB » — (Bring Back Benji. Ramener Benji.)
— Que signifient ces lettres, M. Miller? demanda le policier.
— Rien en particulier. Juste des griffonnages.
— Hummm!… marmonna Sullivan, sceptique.
Et il joignit la chemise à son propre dossier,
marqué, lui, de deux énormes lettres: MM — (Moonie Manquant).
Puis Sullivan intima aux trois — M et Mme Miller et Debbie — l’ordre de ne pas quitter leur chambre.
— Je reviendrai, dit-il, avec des documents officiels vous mettant en accusation pour complicité dans un enlèvement.
Et il partit.
En dépit de leur épuisement, les trois suspects ne purent fermer l’œil de la nuit. La mère et la fille, étendues sur le lit, s’attendaient à ce que, d’une minute à l’autre, on vienne les chercher pour les amener en prison. Charlie, lui, s’était assis face à la fenêtre. Tout en regardant les trois voitures de police stationnées de l’autre côté de la rue, il ruminait sa peine. Son dernier espoir, il le plaçait dans l’ingéniosité des gars en charge de Benji.
Vers 9 heures du matin — longtemps après notre appel — , on avait frappé à la porte. Charlie était certain que c’était la police avec des mandats d’arrêt. Il se trompait. C’était Larry Shapiro, un jeune avocat envoyé par le Docteur Leof. Il apportait d’autres mauvaises nouvelles. Les Moonies s’assemblaient dans le hall d’entrée de l’hôtel pour une conférence de presse sur l’enlèvement. De plus, l’avocat de l’Église de l’unification avait menacé de recourir aux bons offices de la police fédérale (FBI) si Benji n’était pas libéré dans les 24 heures. Sur ce, Shapiro invita les trois suspects à le suivre.
Tous trois eurent à passer par le hall où l’avocat Moonie lisait sa déclaration à la presse. Des journalistes les entourèrent, cahiers et crayons à la main, mais ils pressèrent le pas vers la porte, se refusant à tout commentaire. Une fois dehors, Shapiro les fit monter dans sa voiture qui démarra à toute vitesse. Mais trois camionnettes, remplies de Moonies, se lancèrent à leur poursuite.
Une quinzaine de minutes plus tard, les Miller arrivaient au bureau de Larry Shapiro. En chemin, on avait semé les Moonies. Plus aucune trace des chenapans.
Tout le monde était en train de siroter un bon café quand un associé de Shapiro, pas encore au courant des derniers événements, entra.
— Sur le trottoir, à notre porte, dit-il, il y a un lot de jeunes gens à l’allure étrange. On dirait des Moonies. Que veulent-ils?
À ce moment, on frappa à la fenêtre. Un groupe de jeunes, au cheveux coupés très court, offraient du café et un gâteau et demandaient par signes d’ouvrir la croisée. Derrière eux, plusieurs autres jeunes gens, vêtus de blanc, balayaient le patio dans une scène qui évoquait les films de Fellini.
— Bigre! soupira Shapiro. Des Moonies!
Brève consultation. Descente rapide au garage.
Une voiture, avec l’associé au volant, part la première. Quelques minutes plus tard, Shapiro s’en va avec les Miller. Le leurre a réussi, mais seulement en partie. Au lieu de trois camionnettes, il n’y en a plus qu’une à les suivre.
Pendant une dizaine de minutes, Shapiro conduisit à toute vitesse, s’engageant sur les petites rues, revenant à l’autoroute, dépassant de longues files. Rien n’y fit. Le chauffeur Moonie ne se laissait pas distancer. On arriva ainsi au poste de péage du pont Golden Gâte. Là, le Moonie commit une grave erreur. Il changea de ligne et se trouva sur le pont avant la voiture qu’il poursuivait. Shapiro profita de cette fausse manœuvre.
— Excusez-moi… dit-il au percepteur… C’est une urgence… Laissez-moi faire demi-tour…
L’avocat sortit plusieurs cartes d’identité impressionnantes. L’homme se laissa convaincre.
D’assez mauvais gré, il ordonna à plusieurs chauffeurs de faire marche arrière. Comme il allait réussir à libérer le chemin pour Shapiro, celui-ci aperçut la camionnette Moonie qui revenait sur une voie en sens inverse. Comment le Moonie avait-il pu réussir à tourner sur le pont? Shapiro n’essaya pas d’éclaircir ce mystère. Il se remit au volant, pesa sur l’accélérateur, passa le préposé à la perception médusé, croisa le Moonie et fila à vive allure.
Mme Miller et Debbie étaient pâles et tendues. Charlie, lui, siffla longuement, puis il rit de bon cœur. Jamais plus, il ne devait revoir un Moonie.
Pendant ce temps-là, au cottage du Dr M., la tension montait. Keith, l’homme des montagnes, alerté par téléphone, nous était arrivé avec les journaux du matin. On y rapportait notre aventure. « MOONIE KIDNAPPÉ » titrait en grosse manchette le San Francisco Examiner. De son côté, le Oakland Tribune titrait son article, également en première page: « UN MOONIE DISPARU ». En page intérieure, le journaliste écrivait: « Les parents canadiens d’un homme de 27 ans, membre de l’Église de l’unification, l’ont enlevé dans l’espoir de le déconditionner. »
L’espoir auquel se référait l’article s’évanouissait rapidement. Après une longue nuit de sommeil, Benji venait de se lever, aussi silencieux et aussi fermé que la veille au soir. Lenny essayait de nouveau de prendre d’assaut l’impassible forteresse quand Charlie Miller nous téléphona la dernière nouvelle. Grâce à un avocat débrouillard, il venait d’échapper aux Moonies avec son épouse et Debbie.
D’un commun accord, il fut résolu que les Miller ne viendraient pas à notre cachette. Ils étaient peut-être surveillés par la police et les Moonies. D’ailleurs, la tension artérielle de Mme Miller demeurait élevée et requérait les soins d’un médecin. Nous essaierions donc de nous dépanner seuls.
Neil Maxwell ne nous trouvait toujours pas de déconditionneur. Une probabilité se précisait: la police allait nous découvrir avant que nous puissions aller plus avant.
Nous continuions à accumuler les bévues. La veille au soir, quand nous avions quitté précipitamment l’hôtel de Berkeley, j’avais, stupide, laissé mon cahier de notes dans notre chambre. Or, j’y avais inscrit les numéros de téléphone de tous nos collaborateurs, y compris celui du Dr M. Comme si cette gaffe monumentale ne suffisait pas, Simon, lui, avait laissé sa caméra avec nos photos sur la pellicule non encore développée.
Les Moonies, de leur côté, réagissaient avec une inhabituelle rapidité. Non seulement ils avaient déjà organisé une vaste campagne de presse, ils avaient encore assigné à plusieurs de leurs adeptes la mission de suivre les plus importants adversaires de la secte. Ainsi le grand chef de la section californienne des Moonies, Mose Durst, avait suivi Neil Maxwell jusqu’à l’épicerie où notre ami s’était rendu, ce matin même.
Le zèle des chercheurs s’expliquait en partie par la valeur personnelle de Benji: il avait de l’argent, une intelligence brillante, des manières de gentilhomme. Comptait aussi la décision récente d’une cours de la Californie. Les Moonies voulaient donner le maximum de publicité au jugement qui interdisait aux parents de garder près d’eux, contre leur gré, leurs enfants adultes.
Quel triomphe pour la secte si elle arrivait à faire condamner les Miller et leurs complices comme kidnappeurs! Selon plusieurs avocats consultés par téléphone, si nous étions pris, nous devrions envisager un emprisonnement d’une dizaine d’années.
Nous avons pris la décision d’informer Benji de notre situation critique.
— Tes parents, lui dis-je, ont des ennuis avec la police. Ta mère souffre de haute tension et se sent plus mal que d’habitude. Et nous, tes copains, nous risquons le pénitencier.
Il ne laissa paraître aucune émotion. Mais j’eus la preuve de l’avoir touché. En effet, pour la première fois il sortit de son silence. Levant la tête lentement vers nous, il nous regarda et dit sur un ton monotone:
— Laissez-moi aller!… Il n’y aura pas d’accusation d’enlèvement.
Sa tête retomba et il se barricada de nouveau dans son silence.
Tiendrait-il cette promesse? Probablement pas. Surtout s’il passait de nouveau par Boonville. D’autres Moonies avaient intenté des procès en dommage contre leurs parents pour des millions de dollars. D’ailleurs, cette question importait peu. Au point où nous en étions, nous n’allions pas abandonner la partie sans livrer d’abord une bataille sans merci. Dans cette dure lutte, nous avions la chance d’être soutenus et encouragés par nos amis et même par de purs étrangers comme Keith.
Ah! le cher Keith, comme il nous était précieux! Grâce à lui, nous pouvions communiquer avec le monde extérieur, au-delà de nos fenêtres camouflées. Son absence au moment de l’enlèvement le mettait à l’abri de tout soupçon. Il pouvait aller et venir sans nous mettre en danger. Tôt le matin, il allait s’approvisionner en bière. Et il en buvait, à grandes lampées, toute la journée. Notre alimentation nous venait également par lui. Elle était variée et substantielle.
Une canette de bière d’une main, un sandwich de l’autre « l’homme des montagnes » nous remontait le moral des heures durant en nous racontant des histoires de son village « La Gloire des Fainéants ». Le Dr M. stimulait également notre courage par sa façon de transformer sa frousse en matière à plaisanterie. D’après lui, le système pénitentiaire allait s’améliorer. S’il devait terminer ses jours en prison, on lui accorderait de la drogue à volonté et le droit de recevoir des prostituées selon son bon plaisir.
Bien qu’à des milles de distance, le Dr Leof parvenait lui aussi à nous aider. Il avait trouvé un avocat pour les Miller. De plus, il se tenait prêt à nous fournir, au besoin, une nouvelle voiture pour fuir vers une autre cachette. De son côté, Neil Maxwell gardait un constant contact avec nous, nous tenant au courant de ses démarches pour trouver un déconditionneur. Des ex-Moonies nous faisaient parvenir des vœux de succès. Quant à nos amis de Montréal, ils nous téléphonaient si souvent que leur compte d’interurbains finit par s’élever à 1000$. Même si tout allait de travers, même si nous ne trouvions pas de déconditionneur, même si Benji demeurait plongé dans son mutisme, notre courage ne fléchissait pas à cause de toute cette chaude sympathie qui nous entourait. Eh oui! Lenny, Simon, Gary et moi-même demeurions debout et confiants malgré tout.
À quinze heures, cette journée-là, nous avons enfin trouvé l’expert tant recherché. Il s’appelait Ford Greene. Quatre ans plus tôt, il s’était rendu à Boonville pour convaincre sa sœur de sortir de la secte. Loin de réussir, il s’était lui-même laissé gagner. Mais au bout de huit mois comme Moonie, il s’était arraché à l’envoûtement. Péniblement, par des efforts surhumains, il s’était déconditionné sans aide. L’opération avait duré une longue année.
Depuis deux ans, Ford Greene agissait comme déconditionneur. Les connaisseurs le tenaient pour le plus efficace de toute la Côte ouest. Il se vantait d’avoir réussi 38 cas sur 40. Ses échecs, disait-il, étaient dus au fait que ses deux patients s’étaient sauvés en cours de traitement. Lui-même et ses parents faisaient l’objet de poursuites de 5,2 millions de dollars parce qu’il avait été accusé d’avoir voulu déconditionner sa propre sœur. Celle-ci, au cours de la session, s’était lacéré le poignet avec un tesson de bouteille. On l’avait transportée à l’hôpital où les Moonies l’avaient récupérée. Dans l’Église de l’unification, on la traitait comme une sorte de sainte.
Pour contrecarrer l’influence de Ford Greene, les Moonies s’attaquaient à sa réputation. On le dépeignait comme un des pires suppôts de Satan. Une tête brûlée qui cherchait à voler les âmes de jeunes idéalistes. Une lamentable incarnation du Mal. Un esprit ravagé et malfaisant.
En l’écoutant au téléphone, je me disais: « Chose certaine, ce gars-là n’a rien d’un efféminé. »
« Si vous m’acceptez, me dit-il, je veux assumer la complète responsabilité de toute l’affaire. Si quelqu’un d’autre intervient, je laisse tout tomber… » Ford fixa son prix: 750$ tout inclus, le temps qu’il faudra… et il suivrait le patient pendant quelques mois après sa guérison… Et Neil Maxwell nous l’avait si fortement recommandé!
C’était cher, mais nous n’avions pas le choix. Nous avons accepté.
Et chacun de se demander, anxieux, qui du déconditionneur ou de la police allait arriver le premier?
Deux heures plus tard, à 17 heures, nous étions à bout de nerfs. Même Keith courait à la fenêtre au moindre bruit. J’étais dans la chambre, parlant sans cesse — en vain! — à Benji. Simon et Lenny sommeillaient dans le vivoir. Soudain, trois coups heurtèrent la porte, trois coups vigoureux. D’un bond, Keith fut à la fenêtre.
— C’est un grand type, dit-il… Je ne le connais pas… Tenez-vous prêts… Je vais lui ouvrir.
S’éveillant, Lenny se prépara au pire, comme nous tous. Nous espérions que ce soit le déconditionneur. Mais c’était peut-être un Moonie.
Quand la porte s’ouvrit enfin, nous avons vu un gaillard de six pieds trois pouces pencher sa haute tête et nous regarder. Sur sa figure, pâle comme de la craie, on voyait de fraîches cicatrices et des points de suture. Un couvre-œil noir voilait l’un de ses yeux. L’autre œil, perçant comme un rayon laser, s’arrêta sur Lenny, pendant que la bouche contorsionnée murmurait:
— Ford Greene!
Encore à demi ensommeillé, le pauvre Lenny crut à un cauchemar, à une apparition, et il dit:
— Mon Dieu!… C’est le Démon en personne!
Chapitre IX
— Aime-moi, Benji!… Aime Satan!
Ford Greene avait approché sa figure à quelques centimètres de celle de Benji. Les yeux dans les yeux, il lui disait en une sorte de sifflement:
— Pourquoi ne pas m’aimer, moi, Satan? N’es-tu pas obligé d’aimer tout le monde?
Assis, le dos cambré, les yeux sans vie, les mains croisées sur les genoux comme une nonne, Benji offrait une parfaite image de la sérénité. Sauf que sa face était trop rouge, ses muscles trop tendus. Sur son front, on voyait palpiter une veine, raidie comme un ressort. Pour la première fois en 24 heures, notre ami était touché en profondeur. Il avait peur.
Le déconditionnement était commencé pour de bon. « Le pire suppôt de Satan » entamait son exorcisme.
Ford Greene paraissait bien dans son rôle. Avec sa figure toute balafrée à la suite d’un récent accident d’auto, il avait un aspect proprement effrayant. D’autant que, son couvre-œil enlevé, ses yeux contusionnés laissaient filtrer un regard macabre. Debout, son corps long et décharné couvrant Benji, il avait l’air d’un épouvantail.
Il venait de nous avertir:
— Pour le moment, Benji est vide de pensées et de sentiments. Psychologiquement, il est mort. Pour arriver à le faire parler, je dois d’abord l’amener à sentir quelque chose. En fait, je vais lui flanquer une peur du tonnerre.
Nous devions l’apprendre plus tard, pendant ce temps, Benji se répétait intérieurement: « Va-t’en, Satan! Va-t’en, Satan! Va-t’en Satan! »
Dès son entrée dans la chambre où je me trouvais avec mon vieil ami, Ford avait joué cartes sur table. Il avait dit:
— Tu considères Moon comme le Messie. Tu crois que le reste du monde, moi inclus, vit sous la dépendance du diable. D’après toi, je suis un suppôt de Satan. Eh bien! moi, je peux te prouver que Satan n’existe pas. Surtout, je veux te prouver que Moon est un sinistre imposteur, un dangereux fumiste. Tu as subi un affreux lavage de cerveau… Avec des positions aussi contradictoires, nous ne pouvons pas être tous les deux dans la vérité. Il s’agit de savoir lequel de nous deux a raison, lequel a tort. Nous allons voir ce qui en est exactement.
Le combat commença tout de suite. Par un flot torrentiel de paroles, Ford défia Benji muré dans son silence, le provoquant de mille et une façons:
— Pauvre type! dit-il. Tu n’es qu’un misérable robot. Tes yeux sont vides et tes pupilles dilatées. Sous ta peau, d’une pâleur cadavérique, tes veines saillent. Tu es un homme mort… Ils t’ont eu, les bandits!… Mais ne t’inquiète pas! Je vais te donner une transfusion de vie, une injection d’âme… Et yeux contusionnés laissaient filtrer un regard macabre. Debout, son corps long et décharné couvrant Benji, il avait l’air d’un épouvantail.
Il venait de nous avertir:
— Pour le moment, Benji est vide de pensées et de sentiments. Psychologiquement, il est mort. Pour arriver à le faire parler, je dois d’abord l’amener à sentir quelque chose. En fait, je vais lui flanquer une peur du tonnerre.
Nous devions l’apprendre plus tard, pendant ce temps, Benji se répétait intérieurement: « Va-t’en, Satan! Va-t’en, Satan! Va-t’en Satan! »
Dès son entrée dans la chambre où je me trouvais avec mon vieil ami, Ford avait joué cartes sur table. Il avait dit:
— Tu considères Moon comme le Messie. Tu crois que le reste du monde, moi inclus, vit sous la dépendance du diable. D’après toi, je suis un suppôt de Satan. Eh bien! moi, je peux te prouver que Satan n’existe pas. Surtout, je veux te prouver que Moon est un sinistre imposteur, un dangereux fumiste. Tu as subi un affreux lavage de cerveau… Avec des positions aussi contradictoires, nous ne pouvons pas être tous les deux dans la vérité. Il s’agit de savoir lequel de nous deux a raison, lequel a tort. Nous allons voir ce qui en est exactement.
Le combat commença tout de suite. Par un flot torrentiel de paroles, Ford défia Benji muré dans son silence, le provoquant de mille et une façons:
— Pauvre type! dit-il. Tu n’es qu’un misérable robot. Tes yeux sont vides et tes pupilles dilatées. Sous ta peau, d’une pâleur cadavérique, tes veines saillent. Tu es un homme mort… Ils t’ont eu, les bandits!… Mais ne t’inquiète pas! Je vais te donner une transfusion de vie, une injection d’âme… Et je vais rester le temps qu’il faudra, un jour, un mois… ou un an.
Sur ce, Ford sortit. Je demeurai seul avec Benji. La scène grotesque à laquelle je venais d’assister m’avait mis mal à l’aise. Je me tortillais sur ma chaise.
— C’est plutôt brutal, bredouillai-je. Il y a quand même beaucoup de vrai dans ce que Ford vient de dire.
Benji sembla m’avoir écouté. Je crus voir passer sur son visage un vague acquiescement.
Filleul d’un ancien membre du Congrès américain, James Buckley, Ford s’imposait comme un homme brillant, courageux et sensible. Il avait de la présence, comme on dit dans le monde du théâtre. Quand il parlait, ses paroles semblaient chargées d’électricité.
Une crinière de cheveux bruns couronnait sa tête. Ses yeux d’hypnotiseur vous prenaient et vous soupesaient avec une lucidité impressionnante. Puis, soudain, toute cette puissance se détendait brusquement, et l’on était submergé par un énorme éclat de rire comme par une vague de l’océan.
Tantôt mécanicien dans un garage, tantôt vendeur d’antiquités, il exerçait de temps à autre la profession, encore mal définie, de déconditionneur. Il s’y livrait, corps et âme, comme à un exorcisme. On se demandait comment cette force de la nature avait pu se laisser subjuguer par les Moonies. On avait peine à croire que Ford ait pu vivre des mois dans un état d’esclavage. À un moment donné, comme par une sorte de dédoublement de la personnalité, il s’était vu en train de se détériorer, tant au point de vue mental que physique, et devenir une sorte de robot stupide.
Par un énergique coup de volonté, il s’était arraché à Boonville. Pendant onze longs mois, il s’était libéré peu à peu des saletés dont on avait encombré son psychisme. Il avait lu et étudié. Il avait causé avec des ex-adeptes. Les trois premiers mois, il avait dormi, toutes les lumières de son logis allumées, par peur de Satan. Enfin, il s’était sorti complètement de son cauchemar et avait retrouvé son vrai moi.
Depuis, il aidait les autres à se tirer du pétrin dont lui s’était dégagé seul.
Dès son arrivée, Ford avait resserré les mesures de sécurité. Il avait dépouillé la chambre de Benji de ses ampoules électriques. Un bouteille en plastique remplaça le verre à boire. On enleva la porte et l’on poussa des meubles contre la fenêtre. Par respect pour les convictions actuelles de Benji, on bannit la bière de sa chambre.
Peu après Ford, arriva dans notre cachette Virginia, une récente ex-Moonie, amie de Benji. C’est Neil Maxwell qui l’avait mobilisée. Elle désirait travailler sous les ordres de Ford dont elle était aussi différente que la soie l’est de l’acier.
Professeur débordante de vitalité et de confiance, Virginia avait été attirée chez les Moonies par la promesse — évidemment fausse — de travailler dans une école « nouveau genre ». La jeune femme s’était rendue à Boonville en croyant aller participer à une session d’entraînement pour sa nouvelle occupation. Prise dans la philosophie du camp comme une mouche dans une toile d’araignée, elle avait envoyé sa démission à ses employeurs et adhéré au Projet. Sa mésaventure avait pris fin au bout d’un an, alors qu’elle faisait partie d’une équipe travaillant 20 heures par jour à vendre des fleurs. Les jambes couvertes de plaies infectieuses, l’âme torturée d’angoisse, elle s’était tout simplement enfuie.
Peu après son arrivée chez nous, elle bondit dans la chambre de Benji, toute pétillante de bonne humeur.
— Bonjour, Benji! s’écria-t-elle. Comment vas-tu? C’est un vrai plaisir de te revoir.
Pas un seul muscle ne bougea sur la figure de notre copain. L’intrépide Virginia ne se laissa pas désarçonner pour autant.
— Allons! dit-elle sur un ton enjoué. Tu me connais. Je suis Virginia. Nous avons vendu des fleurs ensemble. Voyons! Tu ne te souviens pas de nos chants, de nos confidences? Benji! Allons, Benji? PARLE! Parle ou je te chatouille.
Virginia avait la verve d’un rossignol et le sourire d’un ange. Après 24 heures de silence et la puissante offensive de Ford, Benji ne put résister complètement à l’assaut d’affectueuses amabilités de son ancienne compagne. En un geste lent, mécanique, il leva la tête. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Virginia, il ouvrit la bouche et prononça quelques mots, comme à contrecœur.
— Je ne veux pas parler, Virginia. Pas ici. Pas maintenant, Je ne parlerai pas.
Paradoxe! À partir de ce moment-là, il ne se cantonna plus dans le silence. Il parla. Comme un enfant timide à une étrangère, il se mit à répondre à Virginia. D’abord par des mouvements de la tête. Puis par des phrases stéréotypées, comme apprises par cœur.
— Le Père dit que Satan est à son meilleur quand il travaille par l’intermédiaire des personnes qu’on connaît et en qui on a confiance. Le Père dit qu’on doit résister… Il faut soumettre les injonctions du cœur à celles de l’intelligence… C’est la seule façon de servir Dieu…
Benji continua à répondre par bribes même lorsque Ford revint. Pour je ne sais quelle raison, l’expert changea complètement de tactique. « Plus fait douceur que violence », avait-il dû se dire. Toujours est-il qu’il était devenu toute suavité, toute gentillesse. Laissant Virginia continuer à causer, il s’installa discrètement dans un coin de la chambre. De temps à autre, il se permettait un commentaire, il posait une question. Petit à petit, un dialogue s’établit. La vraie bataille commençait.
Par suite de l’endoctrinement par les Moonies, les convictions de Benji s’étaient modifiées du tout au tout. Depuis toujours sympathique aux idées de la gauche, il était devenu farouchement anticommuniste. Autrefois partisan des droits de la femme, il parlait maintenant des infériorités féminines. Auparavant gentil et tolérant, il méprisait maintenant tout le monde, sauf les Moonies. Détail encore plus étonnant, le Juif fier de sa race s’était métamorphosé en propagandiste fanatique d’une religion antisémite. Autrefois agnostique, il dissertait maintenant sur les esprits et les démons, les Messies et les serpents, le Bien et le Mal. Dans son nouvel univers, il n’y avait place que pour le blanc et le noir. Le gris n’existait pas.
À son dire, l’humanité vit actuellement dans les ténèbres, la haine et le malheur. Le seul espoir de salut réside dans l’Église de l’unification, dernier bastion de pureté sur la surface de la terre. À la tête de cette Église salvatrice, on a la chance d’avoir Sun Myung Moon. Il est le Messie qui guide ceux qui le veulent bien vers un monde idéal où chacun ne pensera plus égoïstement à lui-même mais s’emploiera à servir les autres.
« Rien, absolument rien, déclarait Benji, ne compte plus dans ma vie sinon un dévouement sans réserve à la personne et à la doctrine du Père Moon. Toute déviation constitue un gaspillage du temps de Dieu.
« Les membres de l’Église accomplissent une œuvre historique grandiose. Chaque instant est d’une vitale importance. On est hérétique quand on s’arrête à douter ou à questionner. Pis encore: on met des bois dans les roues de l’Histoire en marche vers le bonheur. Songer à déserter le mouvement, c’est déjà commettre une faute très grave. On doit obéir aveuglément au Père, le suivre partout où sa sagesse nous guide. »
Si Satan s’insinue dans l’âme d’un disciple sous la forme de doutes et d’hésitations, ce disciple doit l’extirper en répétant, autant de fois que nécessaire: VA-T’EN! VA-T’EN! VA-T’EN!
Le Père a prédit un conflit mondial où le tiers de l’humanité périra. Il faut se tenir prêt à risquer sa vie dans cette guerre sainte. Selon le Père, « rien n’est plus beau que de mourir au champ d’honneur ».
C’est à cette structure mentale que Ford s’attaqua avec toute la fougue dont il était capable. Debout, assis, agenouillé, marchant, arrêté, pirouettant, le diable d’homme employait les méthodes les plus diverses: il interrogeait, argumentait, réfutait, exhortait, prouvait, suppliait.
Le Benji auquel il s’attaquait n’était pas celui que nous connaissions depuis 24 heures. Notre copain était sorti de sa forteresse de silence. On aurait pu le comparer à un jeune talmudiste désireux de libérer de ses erreurs un suppôt de Satan.
Le duel commença par de prudentes prises de contact où les adversaires s’étudiaient l’un l’autre. Ford lançait des questions faciles. Benji se contentait de répéter les assertions de Moon dans son livre Le Principe divin.
— Que faisons-nous sur la terre? demandait Ford.
— Ici-bas, répondait Benji, notre plus grand devoir consiste à servir Dieu en suivant les directives du Père Moon.
— C’est ce qu’ils t’ont dit, Benji. Ce que j’aimerais savoir, c’est ce que, toi, tu penses. Quelles sont tes idées, à toi, là-dessus?
Chez Ford, les questions et les réfutations alternaient, incessantes, pressantes. L’un après l’autre, les sophismes de la doctrine de Moon et de ses adeptes s’écroulaient, pulvérisés.
— Benji, disait-il, écoute-moi bien. D’une part, tu crois en la nécessité d’un amour universel et inconditionnel. D’autre part, tu hais ceux qui ne partagent pas tes croyances. Comment peux-tu concilier le dogme avec la pratique quand ils sont aussi contradictoires?… Comment peux-tu, sans remords, vendre des fleurs à une vieille femme pauvre, lui arracher les quelques misérables sous dont elle a tant besoin, sous le fallacieux prétexte de libérer l’univers de l’égoïsme des hommes ou de sauver des orphelins abandonnés? Tu ne fais que récolter l’argent du diable, Benji. Si je te prouvais que Moon utilise ces dollars pour accroître son bien-être personnel et étendre sa puissance politique… Tu penses avoir appris à aimer. Tu te trompes. N’as-tu pas plutôt appris à haïr? Tu hais le sexe. Tu hais ta famille. Tu te hais toi-même. Peux-tu vraiment prétendre que l’amour inspire toute ta vie? De quelle sorte d’amour s’agit-il? Réfléchis, Benji! Fais appel à la raison. Il n’y a rien de satanique dans le fait de s’interroger ou d’avoir des doutes.
Ford savait diversifier ses attaques.
— Que dis-tu, Benji, demandait-il, des richesses de Moon, de ses activités politiques, des nombreux points obscurs de sa philosophie dont on ne donne jamais le moindre éclaircissement? Que dis-tu des dénonciations incriminantes faites par d’anciens membres qui vécurent dans l’intimité de Moon?
Et il ajoutait:
— Aurais-tu le courage, Benji, de refuser quelque chose au Révérend Moon? Déjà, pour lui, tu as consenti à mentir et à commettre des escroqueries? Que ferais-tu si Moon te demandait de tuer? Obéirais-tu?
— Pas nécessairement, répondit Benji… Nous restons quand même des humains, nous, les Moonies… Je pourrais dire non à Moon…
— Non, Benji, tu ne le pourrais pas. Je te cite Moon lui-même dans son livre Le Principe divin. Il écrit: « Vous devez marcher sur la tête si je vous l’ordonne… Je suis votre cerveau… Vous devez vous tenir prêts à lutter, à mourir même, pour la Corée… »
Ford continuait:
— Qu’arriverait-il si tu désobéissais à Moon?… Tu connais la réponse… Tu n’oses pas le dire?… La voici: Si tu désobéissais à Moon, tu désobéirais à Dieu. Tu deviendrais esclave de Satan. Tu serais passible d’une éternelle damnation. Voilà ce que tu crois, n’est-ce pas?
— Alors, balbutia Benji, d’après toi, je ne serais qu’un robot.
— Exactement, mon pauvre ami, exactement.
Malgré ce premier signe encourageant, il fallait continuer le travail. Il fallait débarrasser l’esprit de Benji de toutes les faussetés que les techniques de Boonville y avaient inculquées en profondeur.
Benji luttait avec courage et intelligence. Souvent il défendait avec beaucoup de logique les illogismes de Moon.
Après quatre heures d’échanges serrés, à la première pause-café, un Ford haletant, en transpiration, nous dit:
— De tous les Moonies dont je me suis occupé, il est, sans doute, le plus brillant, le plus malin, le plus habile.
Après un réconfortant café, la lutte recommença. Virginia était toujours là, présente et attentive, atténuant par sa féminine gentillesse les coups parfois brutaux de Ford, déclenchant des fous rires aux moments opportuns, corroborant par son expérience personnelle les preuves apportées par Ford, l’expert.
— Tu as une peur terrible de quitter l’Église, dit-elle. Je le sais, Benji, parce que je suis passée par là… Pour m’empêcher de partir, on m’a menacée de toutes sortes de malheurs. Je deviendrais vicieuse, dépravée. Je tuerais des gens. D’après les Moonies, les ex-adeptes ne peuvent être que des pervers, des assassins, des prostituées ou des proxénètes… C’est faux, Benji!… La preuve?… Je me suis évadée et je suis une honnête femme… On t’a dit que Satan te posséderait si tu quittais Moon. Ça aussi, c’est archi-faux… Je connais des dizaines d’ex-Moonies. Tous sont des gens normaux…
En dehors de la petite chambre bleue, dans le vivoir, nous ressemblions aux parents d’un grand blessé qui attendent des nouvelles, près de la salle des soins intensifs. Gary et Simon fouillaient le dossier Moon dans l’espoir de trouver de nouveaux renseignements qui puissent aider Ford. Lenny et moi-même allions à tour de rôle près de Benji pour assurer, dans la chambre, la présence continuelle d’un ami bien connu. Keith et le Dr M. nous remontaient le moral en nous contant des drôleries et en nous apportant de l’extérieur des ravitaillements substantiels.
Ce soir-là, il y eut une boustifaille de pizza dans la chambre de Benji. Réunis autour de notre ami, nous les huit « sauveteurs », nous mangions, buvions, bavardions comme autrefois lors de nos rencontres entre copains. Nos babillages et notre gaîté intriguaient visiblement Benji qui gardait un air perplexe et embarrassé.
« Il lui faut une nourriture substantielle et de longues heures de sommeil », avait déclaré Ford dès le début. « Je veux qu’il soit bien portant, nous ne sommes pas chez les Moonies », ajoutait-il.
À dix heures, Benji se coucha et s’endormit presque tout de suite. Pendant que nous préparions du café pour les veilleurs, Ford s’installa par terre dans la chambrette et, lui aussi, s’endormit immédiatement. Dans le cottage, revint un profond silence que seul rompait le ronflement de Benji qui lutta avec son oreiller toute la nuit durant.
Dehors, la pleine lune déchirait les nuages d’un ciel quelque peu timide.
À 6 h 15, Benji s’éveilla, les yeux moins vitreux. Sur des bouts de papier, il se mit à griffonner d’étranges questions à propos de points obscurs du Principe divin. D’après un Ford enchanté, c’était une preuve que l’intelligence de notre malade se remettait à fonctionner.
La matinée passa rapidement. Benji commença à mettre en doute la justesse de plusieurs de ses comportements. Il en discuta volontiers avec nous tous.
Il se demandait pourquoi il avait trompé les gens en leur vendant des fleurs ou en voulant les gagner à son Église. Pourquoi il avait refusé de nous revoir, Marilyn et moi, lors de notre premier voyage en Californie. Pourquoi il avait accepté de suspendre les processus d’une pensée normale pour mieux se soumettre à Moon.
Le simple fait de se poser de telles questions constituait une hérésie pour un Moonie. Était-ce le signe que notre ami était déjà déconditionné? Allait-il en rester à ce point, coquille vide et peu intéressante?
— Ne vous inquiétez pas, nous dit Ford avec un bon sourire. Quand il sera vraiment déconditionné, vous vous en apercevrez… Ça s’en vient!
Benji demanda à regarder notre documentation sur la fortune de Moon et sur ses activités politiques. Puis, à sa demande, tous quittèrent la chambre sauf moi. Il s’agenouilla alors sur le lit parmi les piles de documents, se prosterna vers l’Est, se prit la tête dans les mains et demanda au Père de l’éclairer. Il resta ainsi une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, assis dans le coin, je me disais que nous avions encore un bon bout de chemin à faire avant la délivrance complète.
La prière finie, Ford revint et le débat reprit plus animé que jamais.
— Si Moon n’est pas le Messie, reprit Benji sur un ton désespéré, alors la doctrine du Principe Divin est fausse… Si l’amour de Moon n’est qu’un égoïsme camouflé, alors…
Pour les adeptes de Moon parler ainsi c’était proférer d’affreux blasphèmes. De toute évidence, Benji ne se permettait de telles audaces que dans l’espoir de trouver un substitut à Moon.
Ford hocha la tête.
— J’en suis désolé, dit-il, mais je ne suis pas Dieu. Je ne puis remplacer Moon. Mais il y a une chose dont je suis certain: l’amour de Moon et le tien, tant que tu es son disciple, c’est du faux amour, de l’amour hypocrite et trompeur.
— D’après toi, reprit Benji, l’amour vrai existe-t-il? Où y en a-t-il?
J’intervins.
— Benji! criai-je, de l’authentique affection, tu n’as qu’à regarder autour de toi pour en voir. Ta mère, ton père, nous tes amis, nous avons traversé un continent pour arriver jusqu’à toi et essayer de te sauver. Là-bas, à Montréal, des douzaines de personnes ont dépensé leur temps gratuitement depuis six semaines et ramassé 15 000$ pour nous envoyer ici. Ta mère malade, ton père angoissé sont menacés d’accusations pour enlèvement. Nous-mêmes, si on nous prend, nous risquons des années en prison. Cher Benji, si tu ne vois pas de véritable amour en tout cela, c’est que tu es aveugle.
Le téléphone sonna. C’était le Dr Leof qui demandait des nouvelles. J’allai lui en donner. Lenny me remplaça pendant que Ford se lançait dans une suprême attaque.
— Si Moon est le Messie, dit-il, et si ce qu’il enseigne est vrai, nous sommes tous des méchants, des démons. Mais si nous ne sommes pas des méchants, des démons, Moon est le plus fieffé des menteurs. Il n’a absolument rien d’un Messie. Pour demeurer son esclave, il faut que tu sois un fichu imbécile, un robot insensé.
Et se penchant sur Benji, il lui murmura à l’oreille:
— Que vas-tu devenir? Toi, et toi seul, tu peux choisir ton avenir!
La main de Ford reposait gentiment sur le genou de Benji dont on voyait palpiter la veine de la tempe.
Le lourd silence qui suivit fut soudain rompu par un cri désespéré de Lenny.
— Benji! dit-il. Penses-tu que je suis méchant, possédé du démon?
Les yeux de Benji se posèrent sur Lenny. La réponse affirmative qu’imposait la doctrine de Moon, n’arriva pas à franchir les lèvres de notre ami. Les mots mouraient dans sa gorge et son teint devenait cramoisi.
— Je ne suis pas méchant, Benji. Je ne suis pas possédé du démon. Personne ici ne l’est.
En sanglots, Lenny appuya sa figure sur les genoux de Benji. Celui-ci demeurait impassible, tiraillé entre des forces opposées. Comme dans un kaléidoscope, des images défilèrent à toute vitesse dans son esprit: ses expériences de Boonville, les épisodes de l’enlèvement, ses parents et ses amis angoissés par la perspective d’un emprisonnement… Ils sont supposés être des suppôts de Satan. Mais comment cela peut-il être vrai?
Relevé, et regardant bien Benji dans les yeux, Lenny lui dit:
— Je t’aime, Benji! Nous t’aimons tous!
Lenny le pressa contre lui, fort, très fort.
Soudain, sur la joue impassible de Benji coula
une larme, puis une autre, puis une autre. Notre ami trembla de la tête aux pieds, se mit à pleurer à gros sanglots, agrippa Lenny comme une bouée de sauvetage et s’effondra dans ses bras.
Dans le vivoir où, désœuvrés, nous causions paresseusement à bâtons rompus, nous avons entendu tout à coup un hurlement, assez semblable au cri perçant d’un nouveau-né. Ford sortit de la chambre en coup de vent, comme un médecin accoucheur, et nous lança:
— Vite! Vite! Venez… Il a besoin de vous tous!
En quelques bonds, nous étions devant Benji et Lenny qui pleuraient d’émotion dans les bras l’un de l’autre. Benji se dégagea pour crier nos noms et nous serrer chacun dans une affectueuse accolade. Bientôt, tout le monde tomba sur le lit dans un beau fouillis de bras, de jambes… et de larmes. Sur l’étroit matelas, grouillaient les corps de cinq gaillards trapus, dans un embrouillami en apparence indémaillable. La scène était grotesque. Quand s’opéra le dégagement, tout le monde éclata de rire. Un fou rire contagieux qui disait notre incommensurable joie. Benji, lui, riait à travers ses larmes.
De la porte d’où son sourire illuminait la chambre comme un rayon de soleil, Virginia cria:
— Bienvenue, Benji! Bienvenue à la maison!
Le calme revenu, on constata quelle merveilleuse
transformation s’était réalisée chez Benji. La métamorphose avait été immédiate et complète. Sur sa figure, le masque de sévère impassibilité que Ford avait affronté 21 heures auparavant était tombé comme par enchantement. Les yeux avaient repris leur gaminerie pétillante d’autrefois. La dilatation hypnotique des pupilles avait disparu. Les lèvres s’ouvraient sur un sourire naturel, charmant. Virginia, qui avait vécu cinq mois avec lui chez les Moonies, découvrait pour la première fois ses fossettes quand il riait.
Sa voix elle-même avait changé. Ses gestes, détendus, élégants, soulignaient sa pensée avec à propos.
On dut lui « présenter » Keith et le Dr M. qu’il avait l’impression de voir pour la première fois.
On aurait cru qu’une toute nouvelle personne s’était installée dans son corps. « Nouvelle » pour les autres, pas pour nous, ses copains. Nous, nous retrouvions le cher vieil ami des jours anciens.
Keith se grattait la tête et ne cessait de répéter:
— J’ai peine à en croire mes yeux. Es-tu bien le même type, fou et entêté, avec lequel nous essayions en vain de raisonner, il y a moins d’une heure? Il n’est resté aucune trace du parfait imbécile que tu étais. Tu es devenu un vrai chic gars. C’est pas croyable! Et pourtant c’est vrai!
Benji lui-même nous confiait:
— C’est comme si mon esprit s’était dégagé d’un monde où tout m’apparaissait à travers un prisme déformant. Ou encore, pour employer une autre comparaison, c’est comme si mon intelligence avait été encerclée par une bande élastique. Et tout à coup quelqu’un a coupé l’élastique et je suis revenu à la normale… Qu’une mésaventure pareille me soit arrivée à moi, c’est proprement incroyable. Il me faudra des semaines avant que je puisse traduire en paroles l’expérience que je viens de vivre.
Moins d’une heure après la fin du déconditionnement, Ford embrassait chaleureusement Benji, nous saluait tous amicalement, puis disparaissait dans le paysage. Virginia, elle, resta pour aider Benji à mettre un peu d’ordre dans ses affaires.
Je téléphonai la bonne nouvelle au Dr Leof, qui s’empressa de la communiquer à une mère et à un père au septième ciel.
Puis on redonna à notre cachette son allure de maison en replaçant les portes, les ampoules et les verres aux bons endroits, au grand soulagement du Dr. M. On ouvrit même les rideaux et les stores afin de laisser entrer le beau soleil pour la première fois en deux jours. Quand tout fut en ordre, Benji appela Montréal où tant de gens se demandaient si le déconditionnement réussirait avant l’arrivée de la police. Dès la première sonnerie, Montréal répondit. C’était Mike Kropveld à l’appareil.
— Allô! dit Benji… Comment vas-tu, Mike?…
— Euh!… Qui parle?… Oh! Benji!!!
Benji répondit par son énorme rire, qui ondula pendant quelques secondes sur les 4 000 milles de la ligne téléphonique.
— Oui! je suis Benji… Imagine-toi!… Je suis sorti de mon cauchemar!…
Il fallut rester dans notre cachette deux jours de plus pour laisser à nos avocats le soin de régler nos problèmes avec la police. D’ailleurs, tout le monde était fatigué et avait besoin de repos. Benji dormit presque sans interruption. Il s’éveillait juste pour ingurgiter de copieuses platées de spaghetti.
Quelque 36 heures plus tard, nous sommes sortis pour la première fois en quatre jours. Tout le monde s’est entassé dans la Volvo du Dr M. pour aller à un petit restaurant français, à l’autre bout de la ville.
Quand Mme Miller aperçut son fils, elle se précipita vers lui, pleurant de joie. Elle faillit le faire tomber à la renverse tant elle l’embrassa avec fougue. M. Miller et Debbie rayonnaient également de bonheur. Quand « l’homme des montagnes », Keith, proposa un toast, bien des yeux s’embuèrent.
Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à un bureau d’avocats où le sergent Sullivan nous avait donné rendez-vous. L’officier de police vit Benji en privé pour s’assurer qu’il quittait la Californie de son propre gré. L’entrevue fut enregistrée sur ruban sonore à la demande des Moonies.
Le policier nous ordonna de demeurer en ville une journée de plus pour permettre aux autorités de classer définitivement l’affaire. Personne ne se plaignit de ce délai qui allait nous permettre de remercier nos nombreux collaborateurs: les Leof, les avocats, les médecins; Maxwell, Virginia, Ford, Keith, Mazzoni et plusieurs autres.
Le lendemain, Sullivan nous téléphona pour nous lire son rapport final et nous donner la permission de partir quand nous voudrions.
Le rapport se lisait ainsi: « Déclaré disparu en des circonstances jugées suspectes par ses confrères Il fallut rester dans notre cachette deux jours de plus pour laisser à nos avocats le soin de régler nos problèmes avec la police. D’ailleurs, tout le monde était fatigué et avait besoin de repos. Benji dormit presque sans interruption. Il s’éveillait juste pour ingurgiter de copieuses platées de spaghetti.
Quelque 36 heures plus tard, nous sommes sortis pour la première fois en quatre jours. Tout le monde s’est entassé dans la Volvo du Dr M. pour aller à un petit restaurant français, à l’autre bout de la ville.
Quand Mme Miller aperçut son fils, elle se précipita vers lui, pleurant de joie. Elle faillit le faire tomber à la renverse tant elle l’embrassa avec fougue. M. Miller et Debbie rayonnaient également de bonheur. Quand « l’homme des montagnes », Keith, proposa un toast, bien des yeux s’embuèrent.
Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à un bureau d’avocats où le sergent Sullivan nous avait donné rendez-vous. L’officier de police vit Benji en privé pour s’assurer qu’il quittait la Californie de son propre gré. L’entrevue fut enregistrée sur ruban sonore à la demande des Moonies.
Le policier nous ordonna de demeurer en ville une journée de plus pour permettre aux autorités de classer définitivement l’affaire. Personne ne se plaignit de ce délai qui allait nous permettre de remercier nos nombreux collaborateurs: les Leof, les avocats, les médecins; Maxwell, Virginia, Ford, Keith, Mazzoni et plusieurs autres.
Le lendemain, Sullivan nous téléphona pour nous lire son rapport final et nous donner la permission de partir quand nous voudrions.
Le rapport se lisait ainsi: « Déclaré disparu en des circonstances jugées suspectes par ses confrères de l’Église de l’unification de San Francisco, Benjamin (Benji) Miller a été retrouvé. Le détective Patrick Sullivan a causé avec Benji pendant environ 60 minutes. Au cours de cette entrevue, enregistrée sur une cassette sonore, et tenue en dehors de la présence de parents et d’amis, Benji a convaincu les officiers interviewera qu’il n’est retenu par personne contre sa volonté. M. Benjamin Miller préfère ne pas donner les raisons de son départ précipité de l’hôtel Holiday Inn, vendredi soir dernier. Il tient à déclarer cependant qu’il quitte l’Église de l’unification de son plein gré sans y être forcé ou contraint par qui que ce soit. »
Quelques heures après l’entrevue avec Sullivan, nos bagages prêts, nous partions pour l’aéroport de San Francisco. Nous étions neuf à retourner dans la métropole. Une garde d’honneur nous accompagnait faite d’avocats, de médecins et d’un « homme de la montagne ». On nous remit en souvenir des chandails où s’inscrivait en lettres majuscules CALIFORNIA.
Comme nous nous envolions, nous avons envoyé, du haut des airs, un invisible mais chaleureux merci à l’équipe bigarrée qui nous avait si bien aidés.
À notre arrivée à Montréal, 25 autres amis de Benji nous attendaient pour célébrer dans la joie et l’affection notre triomphal retour.
« Billet pour le ciel » par Josh Freed, partie 1
« Billet pour le ciel » par Josh Freed, partie 3
Moon La Mystification – Allen Tate Wood
« L’empire Moon » par Jean-François Boyer
J’ai arraché mes enfants à Moon – Nansook Hong
« L’ombre de Moon » par Nansook Hong, partie 1
« L’ombre de Moon » par Nansook Hong, partie 2
« L’ombre de Moon » par Nansook Hong, partie 3
« L’ombre de Moon » par Nansook Hong, partie 4
Transcription de Sam Park Vidéo en Français
Témoignages d’anciens membres de la secte Moon
English: